Une BD trompeuse, notamment sur le Tibet
par André Lacroix, le 8 août 2025
Le journaliste français Éric Meyer n’est pas un inconnu, notamment en Belgique : il a rédigé de nombreuses chroniques, souvent très critiques, sur la Chine dans le quotidien Le Soir dont la ligne éditoriale n’est d’ailleurs pas des plus sinophiles. À ne pas confondre avec Claude Meyer (1) qui, lui, porte sur la Chine un regard, lucide certes, mais aussi bienveillant. Chez Éric Meyer, c’est tout le contraire de la bienveillance : dans son nouvel ouvrage, une bande dessinée (2), il se livre à un réquisitoire contre Xi Jinping, dans lequel il recycle, en les arrangeant à sa sauce, des informations – qui ne sont pas des scoops sur les luttes de pouvoir au sommet de l’État chinois, sur la personnalité complexe de son Président et sur les nombreux défis que doit relever cette immense puissance.
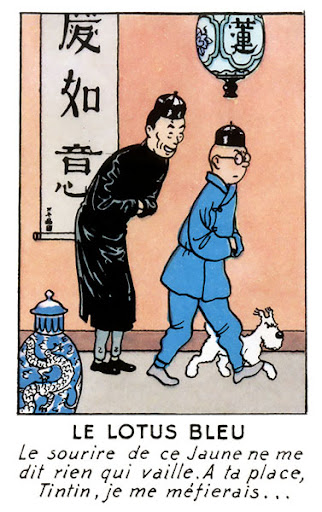
Journaliste ou romancier ?
L’ouvrage que les éditeurs présentent dans la 4e de couverture comme « une enquête rigoureuse » ressemble plutôt à un roman graphique, comme le signale cet avertissement que les éditeurs ont été obligés d’insérer … en tout petits caractères à la toute dernière page : « Pour les besoins de ce récit, certaines scènes et situations ont été imaginées et relèvent de la fiction. » Et ce n’est pas la composition graphique raffinée due à l’artiste italien Gianluca Costantini qui pourrait dissiper le malaise de tout lecteur critique se demandant à juste titre quelle confiance accorder à cet ouvrage de très bel aspect.
Des sinologues et des historiens avertis auront sûrement pas mal de critiques à formuler quant à l’authenticité des différentes péripéties de la carrière de Xi Jinping et quant à la pertinence des jugements formulés sur toute une série de personnalités célèbres et moins célèbres. Voilà un beau sujet de mémoire pour un étudiant en critique historique !
Ma critique est strictement circonscrite
Pour ma part, je me bornerai à analyser les pages 163-168 de la BD consacrées au Tibet et aux Tibétains, un sujet avec lequel je suis assez familier, laissant à d’autres plus compétents que moi de critiquer la manière dont Meyer parle des autres sujets brûlants que sont le Xinjiang, Hong Kong ou Taïwan (3).
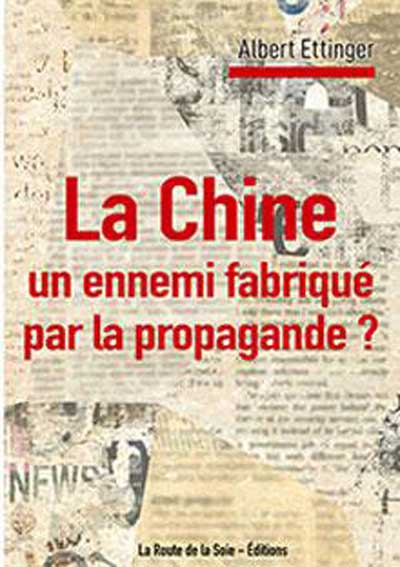
Petite note d’entrée de jeu : à la page 111, Éric Meyer s’emmêle les pinceaux à propos des 55 minorités ethniques de Chine qui ne compteraient, selon lui, que pour 4% de la population globale, la majorité Han représentant pour lui 96%. Mais où a-t-il bien pu aller chercher ces chiffres aberrants ? Tout qui s’intéresse de près ou de loin à la Chine sait que les minorités ethniques y comptent pour 8% de la population chinoise globale. Et si l’on s’en tient à la Chine continentale, le rapport grimpe même jusqu’à 8,89% selon le dernier recensement de 2020. Les approximations de Meyer nous donnent une petite idée du sérieux de son entreprise.
Xi Jinping à l’assaut du Potala !?
La page de garde de ce chapitre donne le ton. On y voit le Président Xi Jinping juché sur un char d’assaut à l’assaut du Potala : belle illustration d’une conception toute personnelle de la déontologie journalistique ! Et la suite et à l’avenant.
Une région sans autonomie ?
Ainsi, en note de la page 165, Meyer relaie l’accusation lancée par le dalaï-lama et ses relais prétendant que « le Tibet est la région la moins autonome de toutes ! » Affirmation gratuite démentie par les faits. Si l’on excepte les domaines régaliens comme la politique étrangère, la défense, la monnaie et les grandes options économiques, la RAT (Région Autonome du Tibet) - ou Xizang (西藏) - gère en toute autonomie de nombreuses compétences qui touchent à la vie quotidienne des habitants : la fiscalité, l’enseignement, le code du travail, l’écologie, etc. (4) Il est piquant de constater que ce sont précisément les pays perdant peu à peu leur autonomie au sein de l’Union européenne qui accusent le Tibet de manquer d’autonomie… Dites-moi, par exemple, cher Monsieur Meyer, en quoi et dans quelles matières la France ou la Belgique seraient plus autonomes par rapport à Bruxelles que la RAT vis-à-vis de Pékin.
Des chiffres fantaisistes
Décidément, la rigueur intellectuelle n’est pas le point fort d’Éric Meyer. En encadré de cette même page 165, il écrit : « Population : 7,6 millions dont la moitié de colons Han », induisant le lecteur en erreur. Alors qu’il parle bien de la RAT (« Surface : 1,25 million de km2 = 2 fois la France »), subitement et sans crier gare, Éric Meyer confond la population de la RAT (grosso modo 3 millions) avec l’ensemble des Tibétains, soit environ 6.450.000, englobant, en plus de la population de la RAT, quelque 3.300.000 Tibétains vivant dans les provinces chinoises jouxtant la RAT (Qinghai, Gansu, Sichuan et Yunnan) et 150.000 membres de la diaspora tibétaine (présents en Inde, au Bhoutan, au Népal, et aussi en Amérique, en Europe et en Australie). Où Meyer va-t-il chercher le total farfelu de 7,6 millions ?
Mais là n’est pas la critique principale qu’on peut faire de ce bout de phrase, mais bien la scandaleuse contre-vérité d’une soi-disant « moitié de colons Han ». En RAT, les Han représentent moins de 9% de la population. Et dans les régions limitrophes, constituant un vaste patchwork multiethnique, les Han ne constituent que la deuxième minorité derrière la minorité tibétaine, parmi une série d’autres minorités (Mongole, Hui, Qiang, Yi, Naxi, Memba, etc.). Si bien que, sur l’ensemble de ce qu’on appelle erronément le « Grand Tibet » ou « Tibet historique », c.-à-d. la RAT + territoires limitrophes, on peut estimer que les Han sont 3 fois moins nombreux que les Tibétains et ne comptent que pour 1 quart de la population globale (5).
Des concitoyens baptisés colons
À cette erreur arithmétique s’ajoute une erreur sémantique, plus grave encore : les Han, même ceux qui, depuis des siècles, sont venus d’autres provinces de Chine pour gagner leur vie sur le Haut Plateau, ne sont en aucune manière des colons, parce que d’abord ils partagent la même nationalité chinoise que les autres citoyens chinois que sont les Tibétains, les Hui, les Qiang, etc. et surtout parce que leur activité bénéficie à tous, contrairement aux pratiques coloniales qui ne profitent qu’à la puissance exploitante. Même si le Tibet et les régions avoisinantes sont situés à l’extrémité occidentale de la Chine et en constituent le « Far West », les mœurs étatsuniennes n’y ont pas cours.
Occupation ou rapatriement ?
Continuons notre analyse critique du roman graphique de Meyer. Il se contente de répéter le mantra officiel selon lequel le Tibet serait « occupé depuis 1959 ». Ignorerait-il que, dès la dynastie Yuan (1277-1368), le Tibet n’a jamais cessé de faire partie de la Chine et que sa soi-disant indépendance autoproclamée en 1913 n’était en fait qu’un protectorat britannique que la RPC (République Populaire de Chine) s’est empressée de récupérer, une fois rétablie l’autorité publique ? Parler d’occupation du Tibet par la Chine, c’est comme si on parlait de l’occupation de la Bretagne ou de la Corse par la France.
Avec de tels préjugés agissant comme des prismes déformants, il ne faut pas s’étonner si la politique menée au Tibet par le Gouvernement local en accord avec Pékin soit grossièrement défigurée par Meyer. Voyons ça de plus près.
Comment enrayer une vague de suicides organisée ?
On se souvient de la vague d’immolations par le feu qui a démarré en 2009 et qui a fait quelque 125 victimes, essentiellement dans des Préfectures à forte minorité tibétaine situées hors RAT (dans le Qinghai, le Gansu et le Sichuan) dans lesquelles le pouvoir religieux, bien plus qu’en RAT, avait tendance à s’ériger en État dans l’État. Face à ces comportements suicidaires de jeunes fanatisés par des revendications séparatistes, les autorités politiques ne pouvaient pas rester les bras croisés : nommé par Pékin pour rétablir l’ordre au Tibet, Chen Quanguo met en place un contrôle strict des quelques monastères qui, de lieux de prières, s’étaeint mués en foyer d’insurrection.
Comme le dit justement Meyer, à l’avant-dernière case de la page 166, « À son arrivée à Lhassa en septembre '2011', Chen Quanguo installe dans chaque monastère une mini-caserne de pompiers, équipée de smartphones, walkies-talkies, voiturettes électriques, extincteurs dernier cri… » Et à la dernière case, on voit quatre pompiers décharger leurs extincteurs sur un candidat au suicide, avec cette légende : « Octobre, monastère de Kirti. À la tentative de suicide suivante, le moine est rejoint en trois secondes et aspergé » de neige carbonique. Atteint de brûlures légères, il est pansé, puis envoyé au camp de travail. »
Mais, au lieu que cette information (correcte) serve à illustrer le bien-fondé de cette action rapide et décisive, Meyer entend l’utiliser pour dénoncer … la dureté de la répression. Sans conteste, il aurait été plus humain de laisser mourir ce brave homme…
La politique dissuasive semble d’ailleurs s’être avérée efficace : ça fait des années qu’on n’entend plus parler d’immolations par le feu au Tibet.
De minables procès d’intention
P. 167, Meyer note avec à-propos que « en un an, 700 commissariats de quartier apparaissent dans les villages, avec personnel tibétain » et que ceux-ci aident les habitants « à remplir leurs formulaires de raccordement à l’eau et au téléphone portable… à régler les conflits de voisinage… », mais pourquoi, obéissant à quelle idéologie, se croit-il obligé d’ajouter : « Faux ! C’est pour ficher chacun avec son ADN, et pouvoir l’identifier même contre son gré » ? Tout journaliste qui se respecte devrait s’abstenir de tels procès d’intention.
Éric Meyer frise le ridicule en prétendant que « (…) Chen ouvre des agences matrimoniales, pour trouver des épouses tibétaines aux 270 000 jeunes Han montés travailler au toit des neiges. » S’il est vrai que les autorités voient d’un bon œil la progression des mariages mixtes, cette tendance a commencé avant l’arrivée de Chen. Selon les chiffres officiels, repris par le Washington Post du 16/08/2014, on serait passé de 666 couples mixtes enregistrés en 2008 à 4.795 en 2013. Il s’agit d’une tendance de fond qui s’explique moins par une injonction politique (6) que par la perte d’influence religieuse des dignitaires de Dharamasala, à savoir le dalaï-lama plaidant pour la préservation des « entités génétiques », (7) ou l’ancien « premier ministre » du « gouvernement en exil » rêvant de « garder pure la race tibétaine… (8)
De soi-disant nomades
Toujours dans son délire sinophobe, Meyer nous présente Chen Quanguo en train de déclarer au téléphone à Xi Jinping : « Camarade Président, je sédentarise massivement les nomades » (p. 168). Or il y a très peu de vrais nomades au Tibet. L’immense majorité des pasteurs du Haut Plateau sont des semi-nomades pratiquant la transhumance ; estive en été sur les très hauts alpages et retour pour l’hiver dans de petites bourgades, relativement confortables. Jamais Chen n’aurait pu, sans se ridiculiser auprès du Président, se vanter de sédentariser massivement les nomades. C’est seulement en Occident, notamment via HRW (Human Rights Watch) qu’on croit à cette fable. Mettre dans la bouche d’un Chinois une fake news occidentale, ce n’est même plus de la fiction ; c’est du trucage.
Les faits sont têtus
Ce qui par contre est bien réel, c’est le développement prodigieux du Tibet. Meyer ne peut que le constater : « Chen accélère les chantiers : autoroutes, lignes TGV, barrages électriques, hectares de serres… Les Tibétains sont désorientés, tout va trop vite. Mais ils voient aussi arriver la sécurité sociale, les retraites… La Chine réprime, mais investit dans des routes, des écoles, et met le prix ! » Au lieu de se réjouir de ces conquêtes sociales sans précédent et d’en féliciter le Président Xi Jinping, Meyer conclut son chapitre par ces mots : « Sous ses pas, le pays des neiges reste amorphe. Comme un peuple à qui l’on a volé son âme ! »
Quiconque s’est rendu ces dernières années au Tibet peut témoigner qu’il en va exactement du contraire : puissamment aidé par le pouvoir central, le Tibet est en plein essor dans tous les domaines : économie, écologie, enseignement, culture, etc., sans pour autant rien perdre de son mysticisme séculaire.
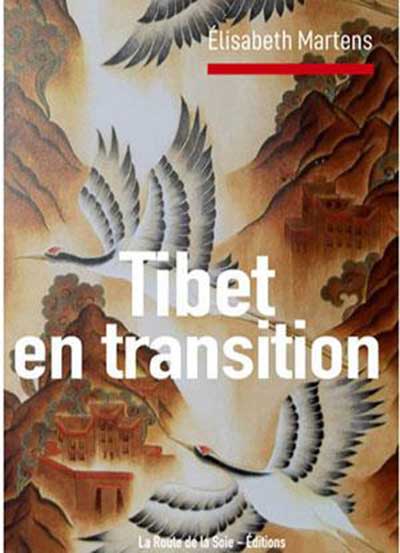
Une petite suggestion pour finir
Cher Gianluca Costantini,
Je me permets de vous conseiller la lecture de Tibet en Transition, (éd. La Route de la Soie, 2024), un gros livre dans lequel Élisabeth Martens raconte le long voyage qu’elle a effectué au Tibet à l’automne 2019. Avec le talent de dessinateur qui est le vôtre, vous pourriez en faire une formidable BD en plusieurs volumes, aux titres évocateurs comme : « Les princesses du Jokhang », « Le grenier des rois », « La route des sommets », « Pèlerinage au Kailash », « Le Royaume de Gugé », « La Rivière du Lion », « Les chères Antilopes »…
Bien à vous.
Notes :
(1) https://tibetdoc.org/index.php/politique/chine-en-general/472-un-regard-sur-la-chine-lucide-et-amical-recension-du-dernier-livre-de-claude-meyer">https://tibetdoc.org/index.php/politique/chine-en-general/472-un-regard-sur-la-chine-lucide-et-amical-recension-du-dernier-livre-de-claude-meyer
(2) Éric Meyer (scénario) et Gianluca Costantini (dessin), Xi Jinping, l’empereur du silence, éd. Delcourt, 2024, 234 pages, cartonné.
(3) Voir notamment Albert Ettinger, La Chine, un ennemi fabriqué par la propagande ?, éd. La Route de la Soie, 2024, un ouvrage très abordable, très bien documenté et abondamment illustré.
(4) Pour plus de détails, voir https://tibetdoc.org/index.php/politique/region-autonome-du-tibet/815-le-xizang-tibet-une-region-autonome-de-chine.
(5) Voir Isabelle Attané, La population tibétaine entre imprégnation et marginalisation, Outre-Terre, 2009/1, n° 21. Les chiffres qu’elle fournit dans son tableau de la page 221 contredisent le titre de son article.
(6) Comme le note finement Daniel Letouche, « L'humilité serait pourtant de mise pour tout ce qui concerne l'appropriation par le politique de tout ce qui demeure du domaine privé » (https://www.erudit.org/fr/revues/cqd/1988-v17-n1-cqd2464/600625ar.pdf). Cette remarque faite à propos de la politique démographique québécoise comporte une vérité de portée universelle.
(7) lors de la Conférence des religions du Monde à Chicago en 1993.
(8) Interview au South China Morning Post, le 30/08/2003.