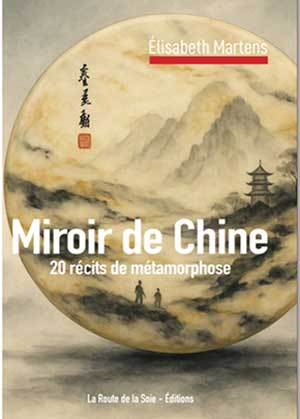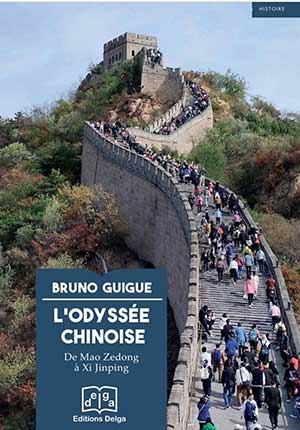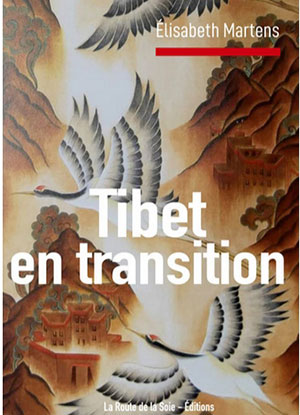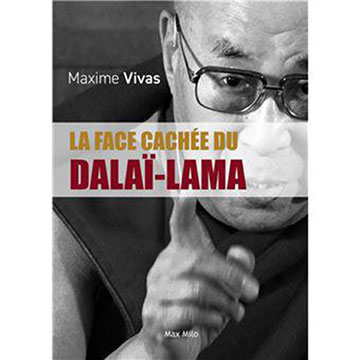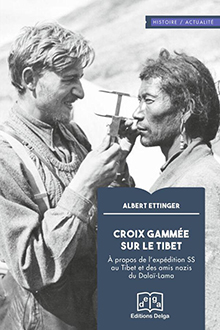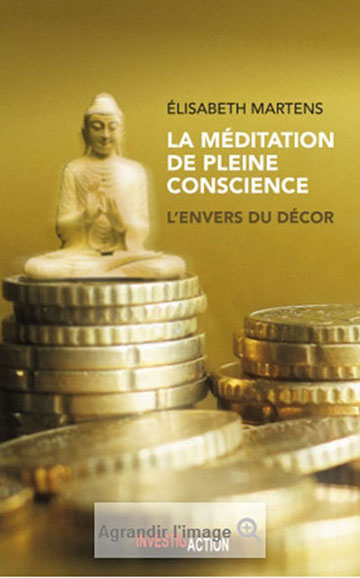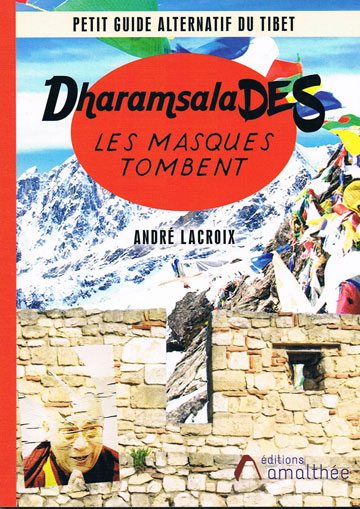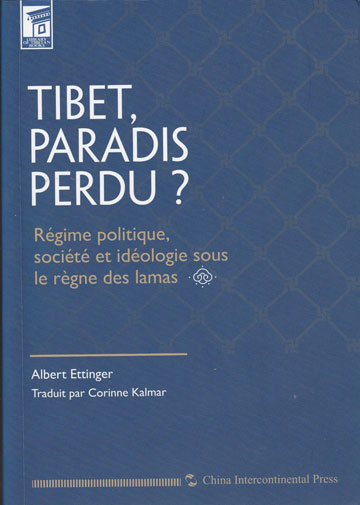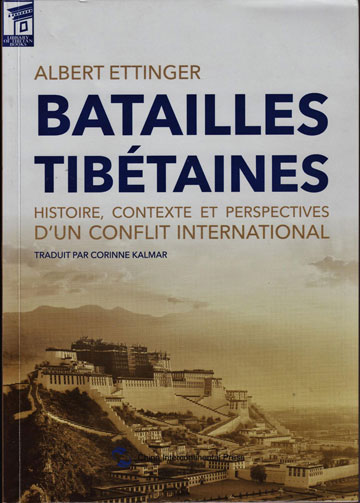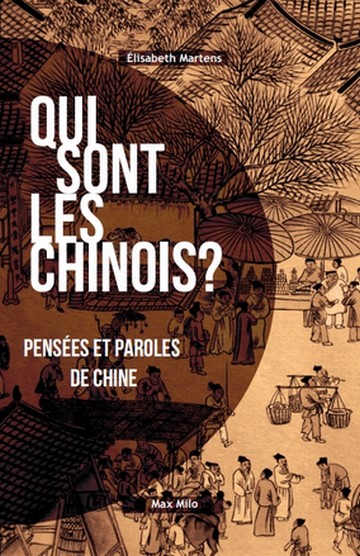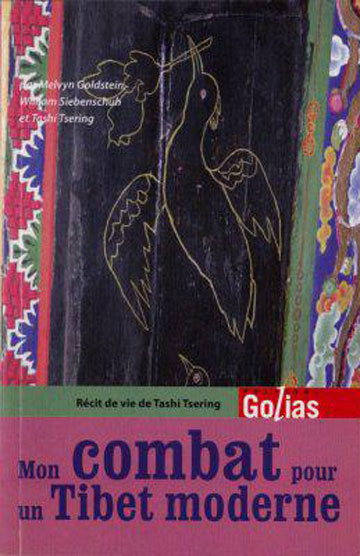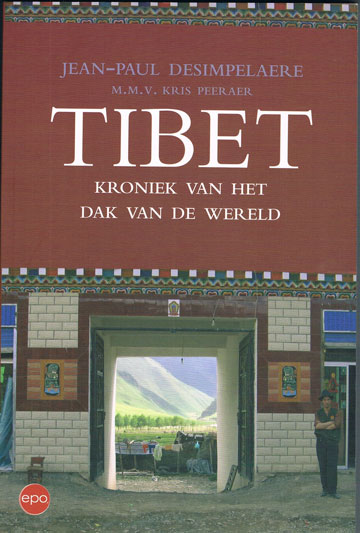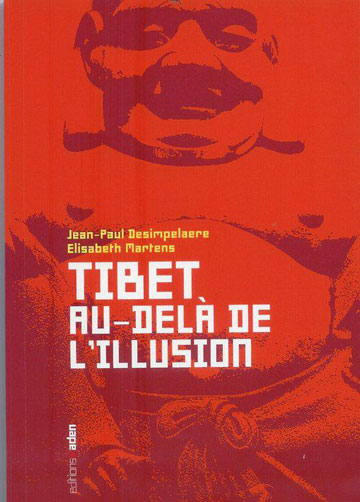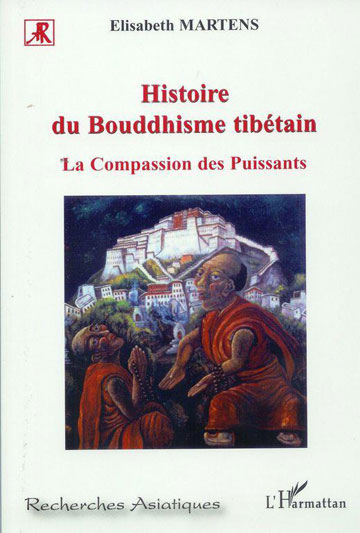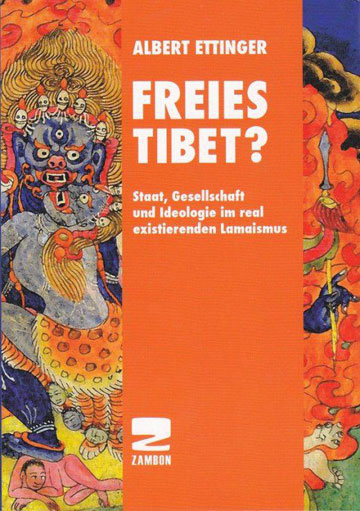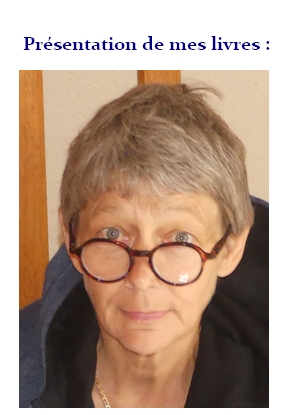à propos de l'autobiographie de Tashi Tsering : censure et « soft power » en Chine
par André Lacroix, le 19 juillet 2015
Le lecteur trouvera ici :
-la traduction d’un article remarquable, en deux chapitres, intitulé : « Une recension de ‘The Struggle for Modern Tibet’ et une comparaison entre éditions ». Il concerne l’autobiographie de Tashi Tsering dont l’édition originale est en anglais, suivie par une édition chinoise. Cet article compare les deux éditions. Il a été rédigé par la chercheuse sino-américaine Xiaoxiao Huang et publié le 26 octobre 2009 par la Columbia University de New York.
-quelques réflexions personnelles suscitées par cet article, surtout par son second chapitre.
Une recension de The Struggle for Modern Tibet et une comparaison entre éditions
par Xiaoxiao Huang, Columbia University of New York, 26 octobre 2009
(traduction française : André Lacroix)
-
La recension proprement dite
The Struggle for Modern Tibet est la biographie d’un Tibétain nommé Tashi Tsering, faite par lui-même et rédigée sous sa forme écrite par Melvyn Goldstein et William Siebenschuh. Tashi Tsering est né en 1929 dans une famille de paysans. Quand il avait dix ans, il a été sélectionné par le gouvernement tibétain pour faire partie à Lhassa de la troupe de danse rituelle du dalaï-lama (en tibétain : le Gadrugpa). Alors qu’il avait une envie énorme d’apprendre, il découvrit rapidement tous les obstacles que la société tibétaine traditionnelle pouvait placer sur la poursuite de son éducation.
Sans se laisser décourager, Tsering réussit à partir en Inde et puis aux États-Unis afin d’étudier. Entre-temps, le Tibet était devenu une partie de la nouvelle Chine communiste. Contrairement à ses amis tibétains de l’aristocratie, Tsering a vu dans l’occupation chinoise l’occasion d’amorcer la modernisation du Tibet. Son optimisme était tel qu’il allait balayer les objections de ses amis américains et le faire embarquer pour la Chine en 1966, alors même que ce pays venait d’entamer la Révolution culturelle. Sans qu’il en ait eu le moindre pressentiment, Tashi Tsering fut accusé arbitrairement et incarcéré. Et c’est ainsi que son objectif d’aider les Tibétains fut ajourné de plus d’une décennie. Après avoir été finalement réhabilité en 1978, il consacra le reste de sa vie à rédiger un dictionnaire anglais-tibétain-chinois et à construire des écoles primaires dans des villages tibétains.
Pourquoi Tsering a-t-il voulu raconter son histoire ? Comme il l’a dit à Goldstein pour le convaincre de l’aider dans ce projet, il pensait que les étrangers avaient besoin de connaître ce qu’étaient les Tibétains ordinaires, c.-à-d. « des Tibétains qui ne sont ni des aristocrates, ni des moines de haut rang, ni des lamas incarnés » (p. viii) [correspondant à la p. 6 de ma traduction française, Mon combat pour un Tibet moderne, éd. Golias, 2010 (= VF)].
Par son récit de vie, Tsering a incontestablement aidé ses lecteurs à avoir du Tibet une vue différente de celle dépeinte par les élites de la société traditionnelle dont le gouvernement en exil en était venu à représenter le Tibet en Occident. Il n’est donc pas surprenant que la perception que se fait Tashi Tsering du Tibet traditionnel soit moins flatteuse que celle des aristocrates.
Tsering nourrit à l’égard de la société tibétaine traditionnelle des sentiments contrastés. D’une part, il est très fier de la manière de vivre des Tibétains au point d’en défendre vigoureusement certains aspects, ceux-là même que les Occidentaux ont le plus de mal à comprendre. Il ne ménage pas sa peine pour prendre la défense de deux particularités de la société tibétaine, intimement liées à sa vie personnelle : l’habitude pour deux frères de se partager la même femme et l’usage répandu chez les moines de prendre de jeunes garçons comme partenaires sexuels. Les pères de Tsering ‒ deux frères ‒ étaient mariés avec la même femme. Tsering explique que la polyandrie se justifie pleinement, car elle empêchait la famille d’être divisée entre frères.
Quant aux relations homosexuelles pratiquées par les moines officiels, c’est, selon le plaidoyer de Tsering, un moyen raisonnable pour eux de rester sains d’esprit, dans la mesure où ces comportements ne violaient pas leurs vœux. C’est ainsi que, lorsqu’un moine de haut rang nommé Wangdu désira le prendre comme partenaire, lors de son service au Gadrugpa, Tsering ne s’y opposa pas. Il était bien conscient qu’en Occident de telles pratiques susciteraient la contestation. Mais il ne se crut pas obligé pour autant de s’en excuser, car il estime que les Tibétains ont le droit d’avoir leurs propres traditions.
D’autre part, Tsering est profondément insatisfait de plusieurs éléments constitutifs de la société tibétaine traditionnelle. Il n’a que mépris pour l’exploitation et les aspects parfois brutaux de la culture traditionnelle. En premier lieu, c’est contre la volonté de sa famille qu’il a été choisi pour faire partie du Gadrugpa. Mais comme il s’agissait d’une obligation vis-à-vis de dalaï-lama, lui et sa famille n’avaient qu’à s’y conformer. Quand commença l’instruction intensive au Gadrugpa, il se trouva constamment victime des coups de fouet du maître. Il détestait ce maître que les garçons surnommaient « Face-Grêlée ».
De plus, une fois devenu le partenaire de Wangdu, il fut l’objet de convoitises d’autres moines. C’est ainsi qu’il fut kidnappé par un moine guerrier du monastère de Sera et forcé à lui servir d’esclave sexuel. Il ne fut relâché que deux jours plus tard. Étant donné que ces moines guerriers constituaient un groupe violent, impitoyable et politiquement puissant à Lhassa, ni Tsering ni Wangdu ne purent rien faire contre eux.
Lorsqu’il s’est plaint auprès d’autres moines officiels, la seule réponse qu’il obtint c’est que « c’était ainsi qu’allaient les choses » (p. 29) [VF, p. 40]. Cet événement a certainement aggravé l’aversion de Tsering pour le « c’est ainsi que vont les choses » dans la société tibétaine. Il s’est demandé comment la culture monastique traditionnelle pouvait réserver les premières places à de tels voyous.
Mais s’il est un aspect de la société tibétaine traditionnelle qui le dérange au plus haut point, c’est l’analphabétisme et le peu de cas qu’on y fait de l’éducation. Tsering avait développé, dès son plus jeune âge, un désir d’apprendre à lire et à écrire.
Il voulait tracer les beaux caractères tibétains comme le faisait son père, sans doute la seule personne du village à être instruite en ce temps-là. Mais le mode de vie tibétain est tel que la tradition peut décréter pour chaque membre de la société exactement qui il est et ce qu’il est censé faire ‒ l’instruction étant complètement inutile, au moins pour la majorité des Tibétains qui ne sont ni moines ni aristocrates. Le Tibétain moyen ne fait pas le lien entre l’éducation et le niveau de vie ou la mobilité sociale. C’est pourquoi l’éducation n’est que faiblement valorisée.
Comme son premier beau-père l’a fait remarquer à Tashi Tsering : « tu es très fort pour apprendre, mais tu n’obtiendras jamais un poste élevé. Tout ce que tu pourras jamais obtenir, c’est une situation modeste où tu resteras assis sans avoir à rien faire. Pourquoi dès lors gaspiller ton temps et ton énergie à ces activités stériles ? » (p. 31) [VF, p. 42]. « Activité stérile », voilà précisément la perception tibétaine de l’éducation. Tashi Tsering est hors norme pour avoir eu une si grande envie d’étudier.
Plus Tashi Tsering en apprenait sur le monde extérieur, plus il réalisait l’énorme retard pris par le Tibet. Tsering en vint à penser que, même si la société traditionnelle n’avait pas eu besoin d’éducation pour fonctionner, c’était maintenant devenu une nécessité pour rivaliser avec les autres nations et pour survivre. Sa recherche personnelle d’éducation est donc devenue partie prenante du combat pour un Tibet moderne.
Contrairement à ses amis aristocrates, il avait été impressionné par l’efficacité et la discipline dont les Chinois avait fait preuve dès leur arrivée à Lhassa. L’APL [Armée populaire de libération] avait construit des routes et rapidement ouvert des hôpitaux et des écoles. En l’espace de quelques années depuis l’arrivée des Chinois, le Tibet avait connu de nombreux changements. Des changements plus grands, comme l’a fait remarquer Tsering, « que tout ce que le Tibet avait vu au cours des siècles » (p. 41) [VF, p. 54]. Le contraste est frappant. Tout en étant fasciné par la modernité du monde extérieur, il ne voulait pas tout changer au Tibet. Il envisageait une espèce de changement devant faire du Tibet une nation moderne compétitive tout en maintenant son identité ethnique distincte.
Les sentiments contradictoires de Tsering à propos du changement le placèrent entre les Chinois et l’élite des tibétains en exil, avec qui il avait noué des liens étroits. Lui et les exilés tibétains étaient du même peuple, culturellement et ethniquement.
Mais politiquement il se sentait écrasé par eux. Les Chinois étaient en train d’aider le Tibet à se moderniser, mais finalement Tsering sentait qu’ils apportaient plus de changements qu’il n’en aurait voulu pour le Tibet. Cette ambivalence de sentiments est parfaitement résumée dans une réflexion, à la fin du livre, quand il écrit : « Je ne désire absolument pas revenir à une situation qui ressemble de près ou de loin à l’ancienne société tibétaine, théocratique et féodale, mais je pense aussi que le prix à payer pour le changement et la modernisation ne doit pas être la perte de notre langue et de notre culture » (p. 200) [VF, p. 234].
Voilà pourquoi il ne parvint jamais à s’identifier lui-même pleinement à l’un des deux camps, qui se sont violemment affrontés depuis : c’est ce qui donne sans doute au récit un intérêt supplémentaire.
-
Une comparaison entre la version anglaise originale et la traduction chinoise publiée à Pékin
La version anglaise originale de « The Struggle for Modern Tibet » a été publiée en 1997 aux États-Unis [= VO]. En 2000, la première édition en chinois était disponible grâce aux éditions Mirror Books ‒ diffusée surtout à Hong Kong et aux États-Unis. Six ans plus tard, en 2006, une traduction chinoise, politiquement revue, a été publiée par les Éditions Chinoises de Tibétologie à Pékin [= VP]. Tandis que la version de Mirror Books s’en tenait fidèlement à l’original, celle des Éditions de Tibétologie laisse entrevoir d’intéressantes modifications qui illustrent la manière dont l’État chinois continue à maintenir sa ligne narrative de l’histoire dans la ligne officielle, même s’agissant d’un livre qui sape la narration du gouvernement en exil bien plus que celle de la Chine.
Ce chapitre s’attelle à comparer les deux éditions (l’original en anglais et la traduction chinoise de Pékin) et à mettre ainsi en évidence le processus éditorial habituel utilisé par les autorités de l’État pour censurer la littérature relative à l’histoire et à la politique du Tibet.
Un thème central de cette censure consiste à minimiser la dimension ethnique du différend. Tashi Tsering utilise fréquemment une distinction entre « les Tibétains » et « les Chinois », impliquant une confrontation entre « autochtones » et « étrangers » ou entre « nous » et « eux ». Pour contrer cette vision, la version de Pékin revisite certains mots-clés pour replacer le conflit dans le cadre d’une opposition entre « le gouvernement central » et « le gouvernement local », de manière à atténuer la dimension ethnique et à n’y voir qu’une affaire intérieure.
Chaque fois que Tashi Tsering fait référence dans l’original au « gouvernement chinois », l’édition de Pékin change ces mots en « gouvernement central ». Ou bien quand Tsering décrit la haine des aristocrates tibétains pour « les Chinois », ces derniers deviennent « les communistes » dans la version de Pékin. Dans le même ordre d’idées, les « troupes chinoises » deviennent l’ « APL » (p. 32]. Il semble que, selon la ligne officielle, certains Tibétains, spécialement les aristocrates, soient autorisés à exprimer leur haine vis-à-vis des communistes ‒ après tout, les « mauvais garçons » ont toujours détesté les « braves gars » ‒ mais qu’en aucun cas il n’est acceptable qu’un Tibétain puisse avoir de la haine pour « la Chine » ou « les Chinois », car cela contredirait la doctrine unificatrice de l’État qui a toujours insisté sur l’appartenance de toutes les nationalités à une seule Chine. Quand dans l’original, Tsering dit que ses amis aristocrates tibétains aux États-Unis « haïssaient les communistes et la Chine, et étaient engagés à libérer le Tibet du contrôle chinois », la version de Pékin estime moins inacceptable que les amis de Tashi Tsering n’aient de la haine que pour « les communistes » et ne soient engagés à libérer le Tibet que du « contrôle communiste » (p. 238).
Un autre thème consiste à expurger les faits impliquant que le Tibet a connu dans son histoire une relative indépendance. Dans plusieurs passages où Tsering fait référence à un « gouvernement tibétain », la version censurée a corrigé en « gouvernement local tibétain » (p. 9). Ce qui pour Tsering est « la capitale » devient simplement « Lhassa » (p. 10). Et, bien sûr, un Tibet politiquement correct n’a pas pu avoir un « gouvernement traditionnel ».
C’était seulement le « Kashag » (p. 12). Quand Tashi Tsering mentionne en passant que « le Tibet avait sa propre monnaie », la version de Pékin laisse tomber « sa propre » pour ne garder que « le Tibet avait une monnaie » (p. 5). Tashi Tsering fait référence à M. Tolstoy qui, dans l’original, a voyagé à travers « le Tibet et la Chine » durant la première guerre mondiale ; dans la version de Pékin, il a seulement voyagé à travers « la Chine » (p. 63).
La différence la plus remarquable apportée par la version de Pékin, c’est que les récits des deux rencontres de Tashi Tsering avec le dalaï-lama ont été supprimés. C’étaient pourtant des moments forts dans la version originale, étant donné que Tashi Tsering [, lors de sa première entrevue,] était soucieux d’obtenir pour son projet l’approbation du dalaï-lama. À la place, la version de Pékin publie, en première page, une photo en couleur, prise en 1988, de Tashi Tsering avec le 10e panchen-lama, qui ne figurait pas dans la version anglaise. L’intention de rabaisser l’influence du dalaï-lama est évidente.
Dans l’original, l’épilogue en entier est consacré à la seconde entrevue de Tsering avec le dalaï-lama. Pour contourner ce fait, la version de Pékin présente un nouvel épilogue écrit par Tashi Tsering, dans lequel il n’est nullement fait mention du dalaï-lama. Ce nouvel épilogue commence par expliquer la différence entre les titres de l’édition anglaise et de l’édition chinoise. Quand la version anglaise a pour titre « The Struggle for Modern Tibet », la version chinoise s’intitule : « Le Tibet, c’est chez moi » (*). Tsering affirme à l’usage de ses lecteurs de la Chine intérieure : « … mais c’est seulement une différence de titres ; le contenu de ces deux versions est rigoureusement le même » (p. 186).
Ou ainsi l’avait espéré Tashi Tsering…
|
(*) J’ai trouvé une mention de cet ouvrage sur le site « Amazon.com », sous la référence Tibet is my home, (Paperback – 1991) avec une photo de la 1ère de couverture où l’on pouvait lire le titre en chinois. Étant donné mon ignorance du chinois, j’ai demandé à ma fille Fabienne Lacroix, qui est sinologue, comment traduire exactement ce titre en français. Voici sa réponse : « 西藏是我家 (en pinyin : Xizang shi wo jia). Traduction la plus fidèle : Le Tibet, c'est chez moi. » |
Réflexions personnelles sur l’article de Xiaoxiao Huang
-
Sur la recension proprement dite
Cette recension témoigne d’une lecture attentive de The Struggle for Modern Tibet. Elle donne une excellente image de cette personnalité hors du commun qu’a été Tashi Tsering. En peu de mots, elle décrit parfaitement ses motivations et ses réalisations dans un contexte historique particulièrement tendu. Mme Xiaoxiao Huang me permettra toutefois d’émettre les quelques réserves suivantes.
Elle écrit que la polyandrie empêchait (prevented) la division du patrimoine, alors que le présent aurait été plus indiqué, cette coutume étant encore en usage ci et là au Tibet, comme l’écrit d’ailleurs Tashi Tsering : it is common in Tibetan society for brothers to take a wife jointly (VO, p. 7) et pas it was common.
En revanche, on aimerait avoir la certitude que le temps passé se justifie quand, à propos de la pédophilie des moines tibétains, Xiaoxiao Huang nous dit qu’elle était tolérée dans la mesure où elle ne violait pas leurs voeux (did not violate their vows) : mon inquiétude concerne essentiellement la situation actuelle dans les régions limitrophes de la RAT (Région autonome du Tibet), au Qinghai, au Gansu, au Sichuan et au Yunnan, là où Pékin n’a pas encore réussi à empêcher le recrutement de garçonnets dans les monastères.
Et quand, à propos de la volonté d’un moine officiel de haut rang de prendre Tashi Tsering comme partenaire sexuel, Mme Xiaoxiao Huang dit simplement que ce dernier l’a accepté (Tsering accepted it), on aurait aimé qu’elle signale que Tashi Tsering n’avait alors qu’une quinzaine d’années et que, de plus, le patronage du moine Wangdu, lettré et influent, constituait pour l’adolescent qu’il était une chance unique, sinon le passage obligé, de voir se réaliser son vœu le plus cher, à savoir accéder à une éducation de qualité.
Autre petite imprécision dans la recension : Xiaoxiao Huang nous dit que, pendant son service au Gadrugpa (la troupe de danses traditionnelles du dalaï-lama), le petit Tashi Tsering s’était trouvé constamment victime des coups de fouet du maître-instructeur (he constantly found himself the victim of the manager’s whipping). Ce n’est pas tout à fait exact ; des coups, certes, Tashi Tsering en a reçu beaucoup : Je porte encore quelques marques, écrit-il, de ces coups quasi quotidiens… au visage, aux mains, aux jambes (VF, p. 27 correspondant à la p. 17 de la VO), mais il ne mentionne qu’une seule séance de fouettement proprement dite, dont la reviviscence au cours d’un cauchemar, fournit la matière du prologue (VO, p. 3-5 ; VF, p. 11-13) et dont il précise, qu’elle a comporté vingt-cinq coups de fouet sur ses fesses nues (VO, p. 32 et VF, p. 43).
En analysant les sentiments mêlés qu’a pu avoir Tashi Tsering ‒ entre ses amis tibétains exilés, dont il était culturellement et ethniquement proche et les révolutionnaires chinois dont il partageait l’idéal politique ‒ , Xiaoxiao Huang affirme qu’il ne parvint jamais à s’identifier lui-même pleinement à l’un des deux camps (he was never able to fully identify himself with either camp). Incontestablement, Tashi Tsering n’a pas pu faire l’économie de cette tension, comme le résume si bien le titre « Between two worlds » de la notice nécrologique qu’Ann Wroe lui a consacrée dans « The Economist » (20/12/2014).
Il n’empêche qu’il a choisi son camp lorsqu’il a refusé de servir la cause des exilés, qu’il a refusé de se laisser acheter par Gyalo, un des frères aînés du dalaï-lama, et qu’il a décidé de rentrer au pays pour aider les gens du peuple tibétain du Tibet. C’est ainsi qu’avec le concours des autorités locales il a pu fonder des dizaines et des dizaines d’écoles sur le Haut Plateau. C’est ainsi, comme l’a d’ailleurs très bien dit Xiaoxiao Huang quelques lignes plus haut, que sa recherche personnelle d’éducation est donc devenue partie prenante du combat pour un Tibet moderne (His personal pursuit of education thus became part of the struggle for a modern Tibet)…
Ces quelques réserves somme toute mineures n’enlèvent rien à l’intérêt de l’article de Xiaoxiao Huang, dont la probité intellectuelle ne peut être mise en doute ; ainsi, par exemple, les extraits qu’elle cite sont tous très exactement référencés. C’est pourquoi, dans mon ignorance du chinois, je fais entièrement confiance à cette traductrice éminente quand elle relève avec minutie plusieurs différences frappantes entre la version originale et la version chinoise officielle.
2. Sur la comparaison entre la version originale et la version de Pékin
Remarque préliminaire
Que les mémoires de Tashi Tsering, fruit d’une collaboration entre un patriote tibétain et deux universitaires américains, aient été traduits en chinois et diffusés officiellement, cela constitue incontestablement un fait positif qui témoigne d’une certaine ouverture de la part des autorités de la RPC. Positif assurément le fait que les citoyens chinois Han et non-Han, aient ainsi la possibilité de découvrir une personnalité tibétaine qui, par son engagement et sa haute stature morale et intellectuelle, aurait mérité cent fois une reconnaissance internationale.
Mais ‒ car il y a un mais ‒ il est regrettable que les responsables de la traduction de Pékin se soient permis de « retoucher » un ouvrage garanti par « Copyright © 1997 by M. E. Sharpe, Inc. ».
Bien sûr, la Chine n’a pas la même conception de la propriété intellectuelle que l’Occident. Il n’en reste pas moins que les corrections apportées se révèlent à l’analyse non seulement inutiles, mais encore, selon moi, contreproductives.
1. Négation de toute dimension ethnique
On comprend mal que la version de Pékin se soit braquée sur certains détails, alors même qu’il ressort clairement de la totalité du témoignage de Tashi Tsering que le différend sino-tibétain est essentiellement politique et non ethnique.
Tashi Tsering commence par dénoncer les rumeurs racistes qui circulaient à Lhassa en 1950 : Des bruits de toutes sortes se répandaient çà et là ; certains allaient jusqu’à dire que les Chinois étaient anthropophages” (VF = Mon combat pour un Tibet moderne, p. 48) !
Dès l’arrivée des troupes chinoises à Lhassa à l’automne 1951, Tashi Tsering est étonné et vite séduit par ces soldats qui n’auraient rien pris aux gens, pas même une aiguille. (…) C’est en regardant les Chinois travailler que j’eus pour la première fois une base de comparaison entre notre système et quelque chose d’autre, et, je dois dire, j’étais attiré non seulement par leur efficacité et leur énergie, mais aussi par leur idéalisme affiché (id., p. 53).
Son éveil politique se poursuit pendant ses études aux États-Unis : C’est pendant cette période [1960-1963], je pense, que j’ai commencé à me penser moi-même comme un nouveau Tibétain, un Tibétain « moderne » en réalisant que la présence chinoise avait peut-être réalisé quelque chose que nous n’aurions pas été capables de faire par nous-mêmes (id., p. 94).
Lors de l’hiver 1966-1967, Tashi Tsering a fait partie d’un détachement de Gardes rouges tibétains de son école de Xianyang partis prêcher la bonne nouvelle à Lhassa (voir id., p 129 et ss.). Il note aussi que le Tibet était rempli de Gardes rouges tibétains et d’activistes révolutionnaires tibétains (id., p. 135).
À l’automne suivant, alors qu’il est devenu victime de la Révolution culturelle et emprisonné à Xianyang, il fait cette constatation : mes compagnons de prison étaient principalement des professeurs, des écrivains, des intellectuels et des cadres de l’école. Il y avait aussi bien des Chinois Han que des Tibétains. La Révolution culturelle ne permettait pas que l’origine ethnique dicte le choix des cibles (id., p. 145).
De son incarcération postérieure dans la prison de Sangyib à Lhassa ‒ c’était en 1972 ‒ il écrira : Ce dont je me souviens, c’est l’attitude de l’enquêteur tibétain. L’officier chinois était très expansif. Il criait sur moi sans arrêt. Mais le seul qui m’eût frappé, c’était le Tibétain. Il paraissait aimer son travail et me giflait à la moindre occasion. L’image de ce compatriote me traitant de cette manière est restée gravée dans mon esprit (id., p. 163).
En revanche, il se plaît à décrire l’amabilité de M. Qiao, le directeur chinois de la prison : au lieu de crier sur moi et de m’envoyer des questions hostiles comme mes enquêteurs habituels, M. Qiao se montra aimable et même poli. D’un geste amical, il me montra une chaise et me pria de m’y asseoir (id., p. 163).
L’arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping ne fera que renforcer la sympathie prochinoise de Tashi Tsering, enchanté d’obtenir sa complète réhabilitation doublée de la rétrocession de tout son salaire non perçu du fait de la Révolution culturelle (voir id., p. 198).
Une sympathie réciproque d’ailleurs ‒ comme je le mentionne dans la postface de Mon combat pour un Tibet moderne sur base d’une brochure publiée à Pékin en 2009 ‒ qui explique largement le succès rencontré par Tashi Tsering dans sa création de nombreuses écoles : Ce succès est dû non seulement à la détermination de Tashi Tsering, mais aussi, d’après la brochure, au soutien massif du gouvernement qui assure la formation et la rétribution des professeurs, aujourd’hui au nombre de 592 (soit trois fois plus qu’en 2003), ainsi qu’à d’autres supports financiers, comme, par exemple, celui de la Préfecture de Zibo dans la province du Shandong ou du gouvernement de Shanghai (id., p. 236).
Les mémoires de Tashi Tsering ne sont qu’un plaidoyer pour la fraternité entre Tibétains et Chinois Han et contre les replis communautaristes. Il est évident que son combat a été un combat essentiellement politique, même si sa première confrontation avec le monde Han, incarné par les soldats arrivés à Lhassa a été pour lui un choc de type culturel ou ethnique : Ils pêchaient dans les rivières avec des vers et un hameçon et ils s’arrangeaient pour subvenir à leurs besoins en nourriture, en utilisant les crottes de chiens et les déchets humains qu’ils ramassaient dans les rues de Lhassa pour amender les nouveaux champs qu’ils ouvraient dans un terrain marécageux au bord de la rivière. C’étaient des choses pour nous inimaginables, et pour tout dire, profondément dégoûtantes. Les Chinois ne gaspillaient rien ; rien n’était perdu. Aussi, malgré ma répulsion, j’étais aussi surtout fasciné par l’étendue de leur souci de l’efficacité et par leur discipline. Ils n’auraient rien pris aux gens, pas même une aiguille (id., p. 52-53).
Autrement dit, c’est son étonnement face à des comportements ethniquement nouveaux pour lui qui constitue pour Tashi Tsering le point de départ de sa conscientisation politique. Un tel témoignage pris sur le vif devrait interdire d’évacuer toute dimension ethnique de la problématique sino-tibétaine.
Déjà Sun Yat-Sen affirmait, en simplifiant quelque peu (?) la réalité, que la Chine, comme les cinq doigts de la main, était composée de Han, de Mongols, de Mandchous, de Ouïgours et de Tibétains. Dans la Chine communiste, il y a 55 minorités ethniques reconnues (dont la Tibétaine occupe la 10e place en nombre de ressortissants), constitutives de la nation chinoise. Toute la vie et l’engagement de Tashi Tsering montrent à suffisance que, loin des « identités meurtrières » dénoncées par Amin Maalouf, on peut être à la fois un patriote tibétain et un citoyen loyal de la RPC, comme on peut être à la fois Corse et Français, Basque et Espagnol, etc. Il est donc difficile de comprendre comment, dans un État multiethnique comme la Chine, des censeurs ont cru bon de se montrer « plus catholiques que le pape » (si l’on peut dire), en essayant de gommer toute référence à une différenciation ethnique, comme si les Tibétains étaient des Han et vice versa. En quoi la reconnaissance explicite de la réalité multiculturelle de la Chine pourrait-elle contredire « la doctrine unificatrice de l’État qui a toujours insisté sur l’appartenance de toutes les nationalités à une seule Chine » (voir supra l’article de Xiaoxiao Huang) ? Comment un État qui se proclame multiethnique pourrait-il faire abstraction des multiples ethnies qui le composent ?
On en arrive ainsi à des « corrections » plutôt regrettables à mes yeux, comme le remplacement de « troupes chinoises » par « APL ». Sans doute les traducteurs pékinois avaient-ils leurs raisons de préférer « APL » à « troupes chinoises » dans la mesure où avaient existé précédemment des troupes chinoises … du Guomindang, dans la mesure aussi où plus tard l’APL comptera dans son sein des effectifs issus des minorités nationales, y compris tibétaines.
Il n’empêche que le détachement de l’APL qui est entré à Lhassa à l’automne 1951, c’étaient des troupes chinoises Han.
Les différences avec l’original ne s’imposaient nullement selon moi. Il arrive même qu’elles affaiblissent singulièrement le propos : comment les censeurs n’ont-ils pas compris que, quand Tashi Tsering écrit que ses amis aristocrates haïssaient les Chinois, cela est constitutif d’un crime beaucoup plus grave, à savoir des propos racistes, que s’ils s’étaient contentés de haïr des communistes ?
Quant au remplacement du titre original « The Struggle for Modern Tibet » par « Le Tibet, c’est chez moi », on pourrait y voir une volonté tout orientale de préférer une vision souriante à une opposition frontale. Il est toutefois difficile de comprendre l’évacuation de la dimension expressément politique de l’édition anglaise et son remplacement par un titre nettement moins percutant, qui pourrait tout aussi bien s’appliquer – c’est un comble – au récit d’un exilé nostalgique…
2. Négation de toute trace d’indépendance de fait du Tibet
Aucune personne sensée ne conteste que le Tibet a connu, pendant une quarantaine d’années, une semi-indépendance de fait. La jeune république chinoise, d’abord affaiblie par les affrontements entre seigneurs de la guerre, puis par la rivalité entre les nationalistes et les communistes et enfin par l’invasion japonaise, était alors bien incapable d’exercer son autorité sur sa lointaine province tibétaine. Profitant de cette situation, le 13e dalaï-lama a déclaré unilatéralement une « indépendance » qui n’a jamais été reconnue par le Droit international, ce qui est une condition sine qua non pour qu’une « indépendance » proclamée devienne une indépendance sans guillemets ; sinon les Nations unies seraient composées non pas de 193 pays, mais de plusieurs milliers…
Si le Tibet était effectivement resté dans le giron de la Chine entre 1911 et 1951 comme cela avait été le cas depuis le 13e siècle, si, sous couvert d’indépendance, ce pseudo-État (comme l’appelle Barry Sautman) n’était pas devenu une espèce de protectorat britannique, Mao Zedong n’aurait eu aucune raison d’y envoyer l’Armée Populaire de Libération. Si le Tibet n’était qu’une « expression géographique » ‒ pour reprendre le mot de Metternich à propos de l’Italie ‒ jamais le gouvernement chinois n’aurait eu de raison de créer en 1965 la Région autonome du Tibet.
Vues sous cet angle, les modifications apportées à VO par VP seraient plutôt de nature à rendre moins pertinente la conception chinoise de l’histoire … si elles n’étaient à ce point insignifiantes. Comment, en effet, un « gouvernement tibétain » pourrait-il être autre chose qu’un « gouvernement local tibétain » ? Quelle peut être la portée de remplacer les mots « gouvernement traditionnel » par son exact correspondant « kashag » ?
Si « le Tibet, comme bien d’autres provinces de la jeune république de Chine en proie à l’anarchie, avait « une monnaie », cela pourrait-il vouloir dire autre chose que « sa propre monnaie » ? Ceux qui ont substitué « Lhassa » à « la capitale » ignoreraient-ils qu’en Chine comme ailleurs existent des capitales régionales ou provinciales ? Et M. Tolstoy n’avait-il pas le droit de voyager « à travers le Tibet et la Chine » comme n’importe quel touriste voyageant, par exemple, à travers la Bretagne et la France ?
Plutôt que ces modifications sans intérêt, les traducteurs chinois auraient pu, par des notes en bas de page, fournir aux lecteurs des précisions autrement plus éclairantes. Ainsi, ils auraient pu signaler que le « gouvernement tibétain » − qu’on lui ajoute les qualificatifs « local » ou « traditionnel » ou qu’on l’appelle « kashag » − était un conseil de ministres d’Ancien Régime, composé de notables religieux ou laïques, coupés du peuple. À propos de « Lhassa-capitale », n’était-ce pas l’occasion de rappeler à l’usage du lecteur chinois la réalité administrative de la Chine actuelle (en plus des 4 municipalités et des 2 régions administratives spéciales, 22 provinces, 5 régions autonomes avec chacune leur capitale) ?
À propos de la monnaie tibétaine, c’eût été vraiment instructif de mentionner les observations faites par Alexandra David-Néel, la première femme européenne à découvrir Lhassa en 1924, déguisée en mendiante tibétaine : « Le gouvernement de Lhassa a fondu une vilaine monnaie de cuivre qui sert aux transactions dans la capitale et dans un rayon peu étendu autour de celle-ci. Elle n’a pas cours dans le reste du pays. Des billets de banque ont aussi été imprimés ; ils demeurent un objet de curiosité et, même à Lhassa, les commerçants les refusent » (Voyage d’une Parisienne à Lhassa, Plon 1927, Presses Pocket, 1962, p. 338). D’un point de vue scientifique et pédagogique, de telles notes explicatives auraient été, il me semble, autrement plus valables que les modifications du texte original.
On n’arrive pas à comprendre ces petites manipulations de détail et sans réelle portée, alors que fondamentalement la description que fait Tashi Tsering du Tibet d’Ancien Régime correspond tout à fait au sentiment partagé par la majorité des Chinois selon lequel le Tibet était un pays arriéré qu’il fallait libérer de l’injustice féodale. Qu’un Tibétain de souche, comme Tashi Tsering, caractérise l’ancienne société par ses tares (cruauté, servage, cléricalisme, obscurantisme, analphabétisme, déviances sexuelles, corruption), que sous sa plume les élites tibétaines exilées en Inde apparaissent comme fort peu recommandables (évasion fiscale colossale, collaboration avec la CIA, suffisance de classe), tout cela ne peut qu’apporter de l’eau au moulin de la position chinoise.
3. Négation de la présence du dalaï-lama
Tashi Tsering raconte, dans ses mémoires, que par deux fois il a eu l’occasion de rencontrer le dalaï-lama, une première fois en 1960, à Dharamsala, avant de partir aux États-Unis, et une seconde fois, en 1994, à Ann Arbor dans le Michigan. L’article de Xiaoxiao Huang nous apprend que ces deux passages ont été purement et simplement supprimés dans la version de Pékin. C’est d’autant plus difficile à comprendre que l’image du dalaï-lama qui se dégage de ces rencontres, empreintes toutes deux de politesse et d’amabilités, n’est pas particulièrement flatteuse.
C’est particulièrement vrai lors de la seconde rencontre dont Tashi Tsering a fait l’épilogue de ses mémoires : J’ai dit au dalaï-lama qu’il avait une occasion unique. Il était dans une situation idéale pour conclure avec les Chinois un pacte qui leur serait profitable, à eux et aux Tibétains. « Tant les Chinois que les Tibétains vous écouteront », lui ai-je dit avec insistance. Je souhaitais qu’il rassemble à nouveau notre peuple, qu’il mette fin au gouvernement en exil et qu’il rentre au Tibet (VF, p. 232). Le dalaï-lama s’est contenté de répondre : j’apprécie ton conseil, mais tout ce que je peux te dire, c’est que le moment ne me paraît pas opportun (id., p. 233). Ce dialogue ne peut que renforcer la thèse du gouvernement chinois selon laquelle c’est le refus du dalaï-lama de dissoudre son gouvernement en exil qui constitue l’obstacle majeur à un règlement pacifique du contentieux.
Lors de la première rencontre, celle de 1960, le dalaï-lama avait recommandé à Tashi Tsering d’être un bon Tibétain (id., p. 81). Qu’il se trouve des Tibétains de la trempe d’un Tashi Tsering, pour se considérer comme de bons Tibétains sans pour autant partager les positions politiques du dalaï-lama, ce devrait être du « pain bénit » pour Pékin. Au lieu de ça, de manière difficile à comprendre, les censeurs de Pékin ont supprimé ces épisodes, en se privant d’un argument de poids en faveur de la doctrine officielle de la RPC.
En lieu et place de ces passages supprimés, Xiaoxiao Huang nous apprend que « la version de Pékin publie, en première page, une photo en couleur, prise en 1988, de Tashi Tsering avec le 10e panchen-lama, qui ne figurait pas dans la version anglaise. » Je suppose (mais sans aucune certitude) que c’est la même photo que celle qui a été publiée par l’Association suisse « Pines of Tibet », laquelle mentionne (en allemand) que cette photo a été prise lors de la Conférence des Religions du Monde à Katmandou (Népal), au cours de laquelle Tashi Tsering aurait servi de traducteur anglais au 10e panchen-lama, ce que conteste Melvyn Goldstein dans un courriel qu’il m’a envoyé le 20 octobre 2014 : « Tashi Tsering was not working as his regular translator. This was a special job. » La conférence en question a sans doute eu lieu en 1988 (voir le site « Bahá’i Faith in Nepal »), soit moins d’un an avant la mort du 10e panchen-lama.
Ayant fait part à Melvyn Golstein de mon étonnement de ne pas voir figurer dans The Stuggle for Modern Tibet cette rencontre entre Tashi Tsering et le 10e panchen-lama, il m’a aussitôt répondu « Sorry but neither he [Tashi Tsering] nor I thought it was significant enough. There are so many things and incidents that could be included in a book and choosing between them is very difficult » (13 octobre 2014).
Quelle a pu être l’intention des éditeurs officiels de la version de Pékin lorsqu’ils ont décidé de taire les rencontres éminemment significatives entre Tashi Tsering et le dalaï-lama et de montrer à la place une photo illustrant un fait jugé trop anecdotique par Tashi Tsering et Melvyn Goldstein pour figurer dans un récit dont la destination au grand public imposait une relative concision ? Sans doute le 10e panchen-lama était-il plus « présentable » aux yeux des lecteurs chinois qu’un dalaï-lama considéré comme un partenaire de moins en moins fiable. En publiant cette photo, les éditeurs chinois avaient peut-être aussi la volonté de contribuer à répondre à la rumeur, colportée par certains dissidents chinois et autres indépendantistes tibétains, selon laquelle le panchen-lama, devenu trop critique vis-à-vis de Pékin, aurait été assassiné à l’instigation de Hu Jintao. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas l’adjonction de cette photo qui est contestable ; j’ai moi-même, dans ma traduction française, glissé des photos originales, prises par ma femme en août 2009.
Ce qui pose problème, c’est que le lecteur chinois n’ait pas pu prendre connaissance des rencontres de Tahsi Tsering avec le dalaï-lama, alors que ces rencontres occupent une importance non négligeable dans le récit original.
On est évidemment en droit de se demander si Tashi Tsering a eu sur la traduction chinoise le même droit de regard que celui qu’il a pu exercer sur la version originale en anglais. William Siebenschuh, qui a collaboré avec Melvyn Goldstein pour la mise en forme finale de l’édition en anglais des mémoires de Tashi Tsering, note dans sa préface : Fort heureusement nous réussîmes à boucler une version avant que Tashi ne doive retourner à Lhassa en février 1995. Il put relire chaque ligne de l’original avant de repartir chez lui (VF = Mon combat pour un Tibet moderne, p. 9). A-t-il eu cette possibilité à propos de la version chinoise ? Ou bien a-t-il laissé à ses traducteurs la bride sur le cou, estimant que mieux valait une édition tronquée que pas d’édition du tout ?
Plus précisément, a-t-il accepté que son importante entrevue avec le dalaï-lama soit supprimée au profit d’une rencontre avec le panchen-lama que ni lui ni Goldstein n’avaient jugé bon de mentionner ? Ou bien a-t-il été mis devant le fait accompli ? Si j’avais eu connaissance plus tôt de l’article de Mme Xiaoxiao Huang, j’aurais pu interroger Tashi Tsering lui-même. Malheureusement quand je suis tombé sur cet article, il était trop tard ; Tashi Tsering était décédé depuis quelques mois…
Prolongement de la réflexion en guise de conclusion provisoire
Quelles que soient les réponses à ces questions, on ne peut s’empêcher d’évoquer ici l’expression Traduttore traditore, voire l’image de l’arroseur arrosé… En « croyant bien faire », les censeurs pékinois ont, effectivement, privé les lecteurs chinois de quelques informations utiles, susceptibles de leur faire mieux connaître l’histoire et de renforcer leur adhésion à la politique menée au Tibet depuis soixante-cinq ans… En dépassant le cadre de ce cas particulier, on se pose immanquablement des questions sur le caractère inutile et même contreproductif de toute censure, surtout dans le monde d’aujourd’hui de plus en plus interconnecté.
Bien sûr, la Chine n’a pas le monopole de la censure, de l’autocensure ou de la complaisance vis-à-vis des pouvoirs politiques et économiques. Aux États-Unis, Il suffit de se rappeler comment, par exemple, le « New York Times » et le « Washington Post » ont accrédité les mensonges de l’Administration Bush Jr ayant servi de prétexte à l’invasion de l’Irak en 2003. En Europe, s’ils veulent comprendre les tenants et les aboutissants des enjeux planétaires, les citoyens d’une UE largement inféodée aux USA au sein de l’OTAN, doivent impérativement consulter des ouvrages et des sites alternatifs, et ne pas se contenter de leur « grande presse » qui ne fait souvent que répercuter ce qu’on pense Outre-Atlantique.
Il est, en effet, éminemment paradoxal que les États-Unis continuent à donner le « la » au « monde libre » et que leur influence sur la planète, quoique déclinante notamment en Afrique et en Amérique latine, soit encore si grande. Quand on se souvient notamment que la contribution de la Chine à l'écrasement de l'Axe Berlin-Tokyo lors de la 2e guerre mondiale s’est soldée par un nombre de victimes chinoises plus de vingt fois supérieur à celui des pertes américaines, quand on sait aussi que, depuis 1945, les États-Unis ont mené hors de leurs frontières, aux quatre coins du monde, vingt fois plus d’actions belliqueuses que la Chine (seulement en 1949 en Corée et en 1976 au Vietnam), quand on apprend que, par nombre d’habitants, il y a six fois plus de prisonniers aux États-Unis (730 pour 100.000 aux É.-U. contre 122 pour 100.000 en RPC) et surtout quand on constate aux États-Unis une « paupérisation croissante de la population » (voir notamment, Huffington Post, 23/01/2012) alors que, depuis la fin des années 1980, la Chine a sorti plus de 400 millions de gens de l’extrême pauvreté (c’est du jamais vu dans l’histoire mondiale), on se demande comment il se fait que les États-Unis et leurs fidèles alliés européens bénéficient encore d’un « soft power » supérieur à celui de la Chine.
La réponse se situe sans doute dans l’énorme capacité de l’Occident, acquise par des siècles de conquêtes techniques et territoriales, de raconter l’histoire mondiale à sa manière tandis que la Chine s’est contentée de rester l’Empire du Milieu, sans percevoir suffisamment qu’il était devenu aujourd’hui capital de maîtriser l’outil médiatique à l’échelle planétaire. Prenons l’exemple du Prix Nobel de la Paix accordé en 2010 au dissident Liu Xiaobo.
Si le gouvernement chinois avait mieux évalué l’impression catastrophique pour son image, de la chaise laissée vide lors de l’attribution du prix, n’aurait-il pas dû permettre à Liu Xiaobo de se rendre à Oslo et, parallèlement, inonder les capitales du monde entier de communiqués sur le caractère contestable du personnage : négationniste des crimes coloniaux et chantre de la guerre en Irak pour y exporter la démocratie ? C’eût été sûrement plus avantageux pour l’image de la Chine.
Pour en revenir au Tibet, il est navrant de constater que les contre-vérités forgées à Dharamsala trouvent un tel écho dans nos pays, alors que, principalement en RAT (Région autonome du Tibet), le niveau de vie ne cesse d’augmenter de façon spectaculaire (grâce notamment à une subvention annuelle de 4 milliards d’euros versée par Pékin), que l’espérance de vie des Tibétains a presque doublé depuis la fin de l’Ancien Régime, que la mortalité infantile qui était effrayante a considérablement diminué, que le nombre de centres de santé a été multiplié par … 400, que l’analphabétisme qui, d’après Tashi Tsering, était consubstantiel au bouddhisme tibétain (voir notamment VF, p. 219-220) est en passe d’être vaincu…
Comment se fait-il que l’évocation de la problématique tibétaine provoque assez généralement dans l’opinion occidentale des sentiments antichinois ? Comment expliquer que les fantasmes revanchards de quelques dizaines de milliers d’exilés tibétains comptent davantage aux yeux des Occidentaux que le sort de presque six millions de Tibétains du Tibet, acteurs et bénéficiaires du développement de leur pays ? Ce strabisme idéologique ‒ ou mieux ce scotome ‒ est sûrement dû principalement à la puissance du lobbying exercé par l’ « International Campaign for Tibet » (et par la nébuleuse des officines « Free Tibet » qui gravitent dans son orbite), bénéficiant de fonds publics et privés considérables et instrumentalisant le charisme du dalaï-lama afin d’entretenir un abcès de fixation sur les flancs du géant chinois, devenu un concurrent sérieux sur l’échiquier économique et de plus en plus sur l’échiquier géopolitique.
On peut par ailleurs émettre l’hypothèse que la focalisation occidentale sur la « question tibétaine » n’incommode pas outre mesure les dirigeants chinois dans la mesure où les attaques sont largement prévisibles et qu’il leur est très facile de démontrer que la plupart des critiques sont le fait de Prisoners of Shangri-la − pour reprendre le titre de l’ouvrage magistral de Donald S. Lopez (pudiquement traduit en français par Fascination tibétaine)… On peut aussi affirmer sans crainte de se tromper que si, par miracle, il n’y avait plus de « question tibétaine », l’Occident aurait tôt fait de trouver un autre prétexte pour s’en prendre à une Chine dont les progrès font d’autant plus peur qu’elle n’appartient pas au « monde libre ».
La Chine a toutefois sa part de responsabilité dans la perception négative que l’on a en Occident de sa politique tibétaine. Même si elle a sûrement raison d’être indisposée par certains propos racistes antichinois ayant cours à Dharamasala et par le double langage utilisé par le dalaï-lama, la Chine aurait sans doute intérêt, si elle veut améliorer son image internationale, à cesser de diaboliser le dalaï-lama et sa « clique ».
Elle serait sans doute bien inspirée de prendre l’initiative de ranimer, envers et contre tout, l’esprit constructif qui en 1951 avait rendu possible la rédaction de l’« accord en 17 points sur la libération pacifique du Tibet » et qui en 1954 s’était manifesté par l’accueil chaleureux réservé à Pékin aux jeunes dalaï-lama et panchen-lama par les autorités chinoises et Mao Zedong en particulier. La Chine devrait aussi tenter de poursuivre la ligne tracée un quart de siècle plus tard − après l’arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping − par Hu Yaobang afin de détendre l’atmosphère entre Pékin et Dharamsala.
Toujours dans cette perspective, elle devrait particulièrement veiller à ce que tous les fonctionnaires travaillant au Tibet aient une bonne connaissance du tibétain, selon la recommandation expresse de l’actuel Président Xi Jinping : « Une personne ne peut pas bien servir la population locale si elle ne peut pas parler la langue de la région » (Xinhuanet, 12/01/2015). Elle devrait notamment s’assurer que les cours d’éducation civique dans les monastères soient dispensés avec doigté et selon une pédagogie adaptée.
Voilà déjà longtemps que la Chine a reconnu ses fautes dans la Révolution culturelle et a renoncé à extirper le bouddhisme de l’âme des Tibétains. Dans son juste combat actuel contre les forces centrifuges et contre l’instrumentalisation de la religion à des fins politiques, elle devrait, bien sûr, se garder de toute répression disproportionnée.
Sans perdre la face, elle pourrait même multiplier les gestes d’apaisement comme celui d’accorder une pension de retraite aux religieux tibétains âgés de 60 ans (voir Le Soir du 25 novembre 2011). Elle pourrait aussi encourager les autorités des provinces du Qinghai et du Gansu à imiter la décision prise tout récemment par les autorités du Sichuan de récompenser financièrement les monastères tibétains qui sont restés des lieux de prière et d’étude sans se transformer, comme d’autres, en foyers d’agitation (d’après Radio Free Asia, 30/05/2015).
Étant donné que ces foyers d’agitation sont essentiellement situés hors RAT, dans les Préfectures d’Aba et de Garzé (au Sichuan), de Linxia et de Gannan (au Gansu) et de Hainan et de Golog (au Qinghai), des zones où subsistent des poches de pauvreté, la Chine devrait y investir massivement de manière à diminuer la grogne sociale que certains dignitaires religieux locaux, se sentant encouragés de l’extérieur, n’hésitent pas à récupérer à des fins séparatistes.
De plus, elle aurait tout intérêt à ouvrir largement les portes du Tibet aux visiteurs étrangers : car, quand on a pu voir de ses yeux l’opulence des monastères, l’omniprésence des moines et la vitalité des manifestations culturelles profanes ou religieuses, quand on a pu rencontrer des Tibétains qui œuvrent à la modernisation de leur pays, on ne peut que trouver minables les approximations et contre-vérités répandues dans les productions occidentales, qui sont à la fois révélatrices et productrices d’une dépréciation de l’œuvre de la Chine.
Quand on s’est rendu au Tibet, on ne peut plus avoir que de la commisération pour des films comme l’hagiographique Kundun de Martin Sorcese ou le manipulateur Sept ans au Tibet de Jean-Jacques Annaud, ou, pour se limiter au monde francophone, des bandes dessinées comme Le Bouddha d’Azur de Cosey ou Les Trois Yeux des Gardiens du Tao de Francq et Van Hamme, remplies de préjugés antichinois. Même remarque à propos de la chanson d’Yves Duteil, La Tibétaine, truffée de clichés victimaires à la mode, sans oublier les innombrables publications qui se recopient l’une l’autre sans le moindre esprit critique.
Sans doute, la plupart de ces auteurs, fascinés par le mythe du Tibet, n’ont-ils jamais mis les pieds sur le Haut Plateau….
Modération et ouverture : la Chine aurait tout intérêt à cultiver ces deux vertus qui pourraient certainement contribuer à lui assurer un « soft power » au moins égal à celui dont jouissent les États-Unis, en raison de sa riche culture passée et actuelle et de son statut de grande puissance.
Tel était le vœu de Tashi Tsering (décédé le 5 décembre 2014). C’était à la fois un laïc progressiste et un champion de la tolérance : dans le modeste appartement qu’il occupait au centre de Lhassa à deux pas du Jokhang, tout un coin de la pièce principale, garni de thangkas et de lampes fumantes, était consacré aux dévotions de sa chère épouse, une bouddhiste analphabète très pratiquante, tandis que lui, dans le coin opposé, travaillait devant son ordinateur au milieu de livres en tibétain, en chinois et en anglais, à la promotion de la culture tibétaine au sein de la République de Chine, dans le contexte de la mondialisation.
Dès l’annonce de la réélection de Barack Obama à la tête des États-Unis, coïncidant avec la nomination de Xi Jinping à la tête de la RPC, Tashi Tsering leur a envoyé à tous deux la même lettre, l’une en anglais, l’autre en chinois. Cette lettre est datée du 13 novembre 2012 ; un mois plus tard, Tashi Tsering m’a donné une copie de la version anglaise. C’est un plaidoyer pour une étroite collaboration entre ces deux chefs d’État, Barack Obama (« You are a historic figure not only in the United States but also in the whole world ») et Xi Jinping (“because China is a rising power which is economically tied to America”).
Pour Tashi Tsering, “President Xi Jinping’s relationship with Obama, the American president, is more important than his relationship with any other world leaders”.
Tashi Tsering a vécu trois ans et demi aux États-Unis comme étudiant et il y a séjourné bien plus tard à l’invitation de Melvyn Goldstein. Même s’il n’épargne pas ses critiques de certains aspects de l’ « American way of life » (voir VF, p. 95), ce qui l’a séduit dès son arrivée en 1960 en pleine bataille électorale entre Nixon et Kennedy, c’est la liberté d’expression d’opinions opposées, dont il n’aura pas manqué de garder la nostalgie une fois revenu chez lui, spécialement pendant les longues années qu’il a passées en prison ou en résidence surveillée. Dès 1982 toutefois (voir id., p. 211 et ss.) et en 1985 (voir id., p. 221 et ss.), à l’occasion de deux séances de travail auxquelles il a été invité, il s’est rendu compte que dans l’ère post-maoïste, les Chinois étaient disposés à entendre les doléances ainsi que les points de vue opposés (id., p. 222).
C’est incontestablement dans ce domaine que la Chine doit continuer à progresser : son « soft power » en sortira grandi…