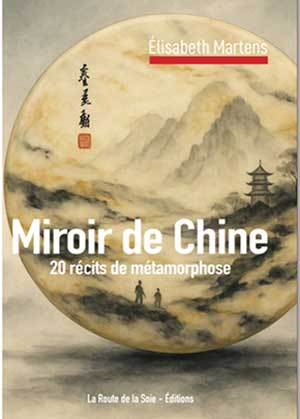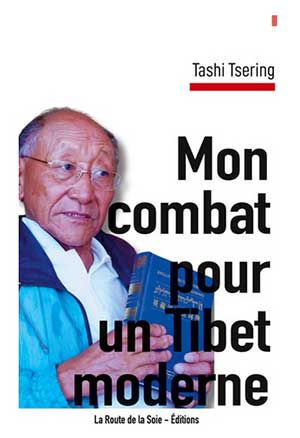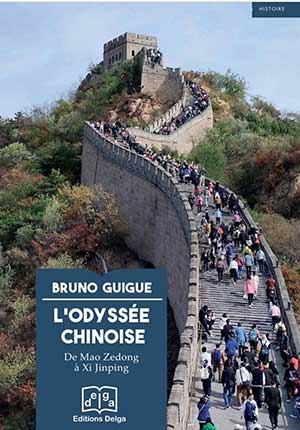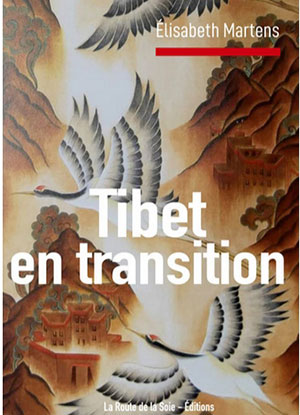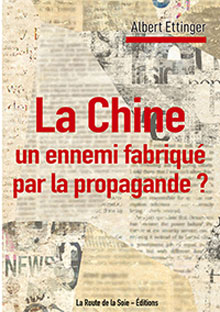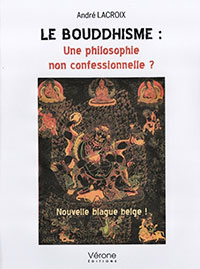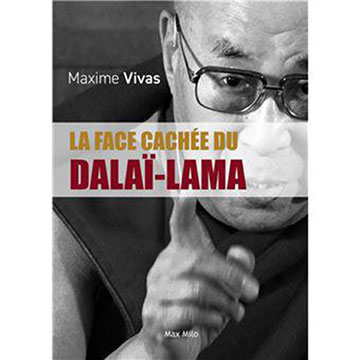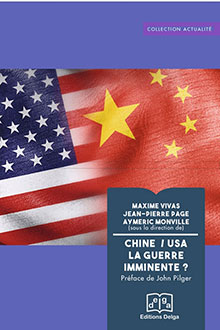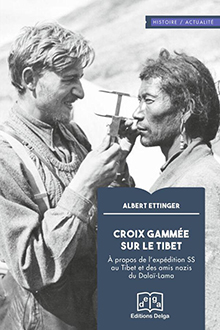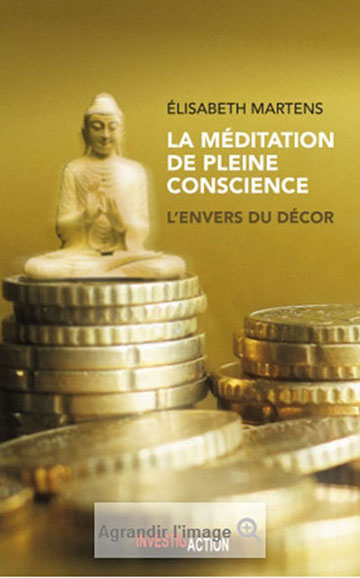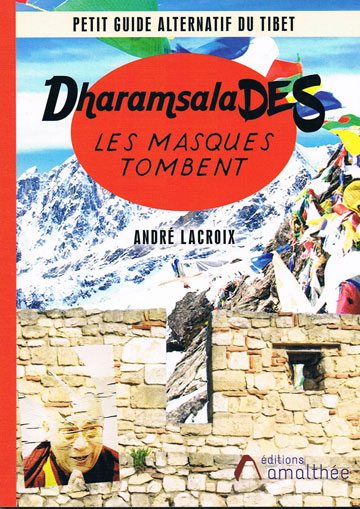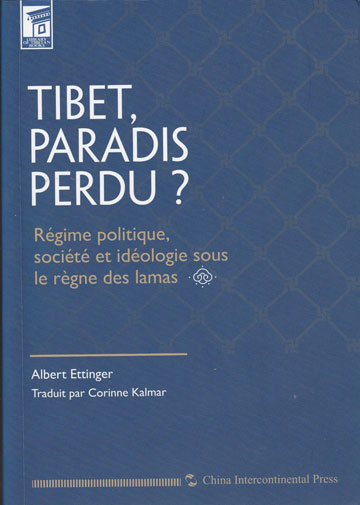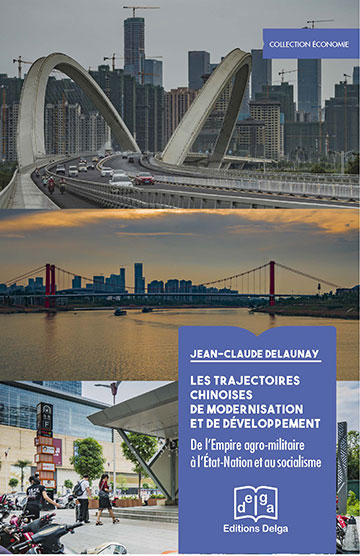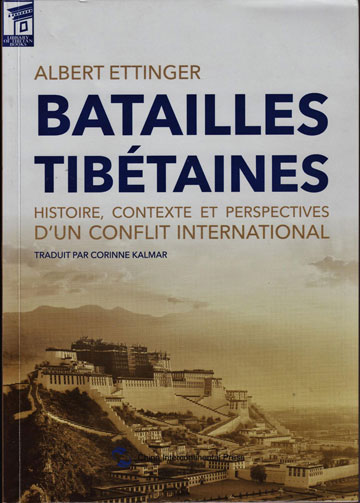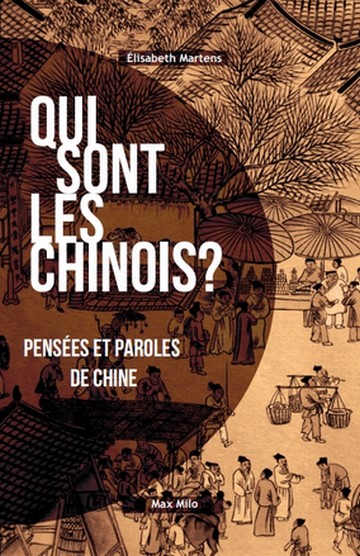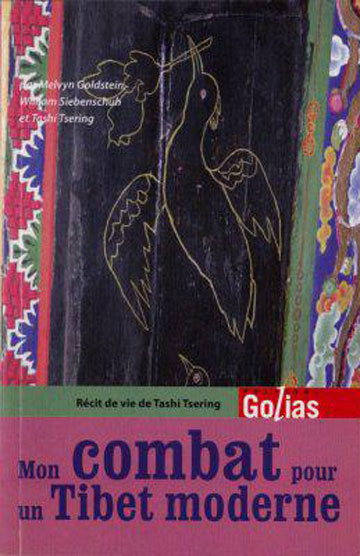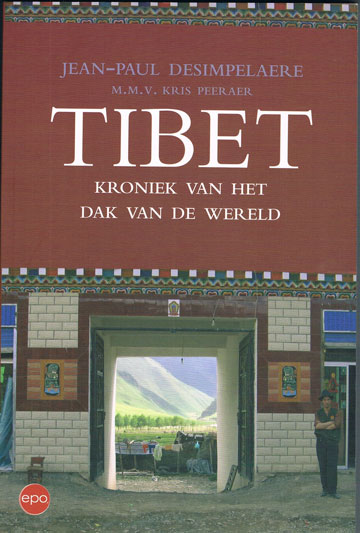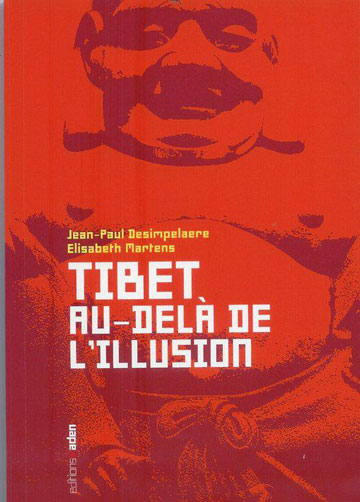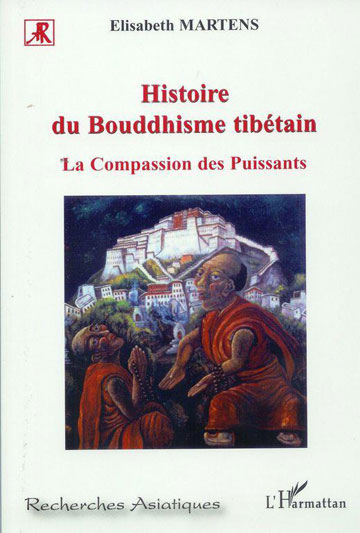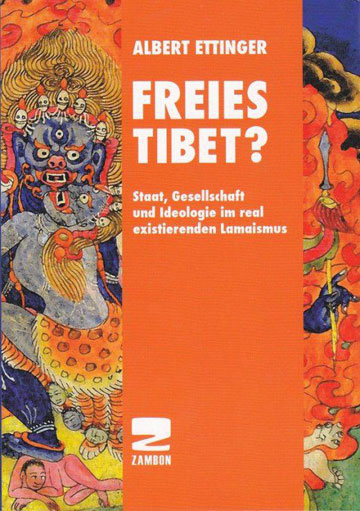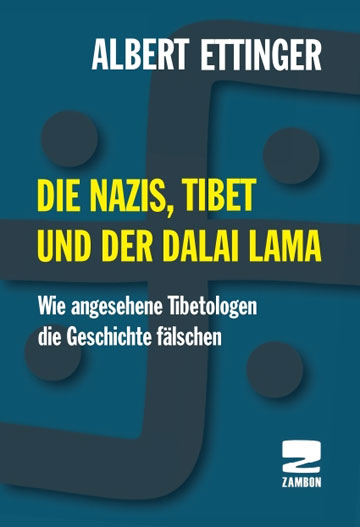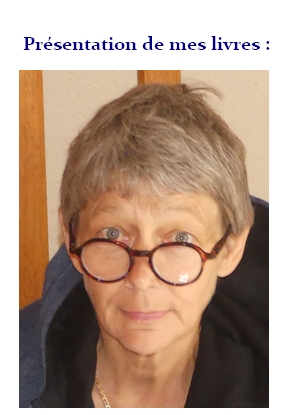Que sont devenus les nomades tibétains ?
par Elisabeth Martens, le 24 juillet 2025
« Il fut un temps où les tribus tibétaines étaient itinérantes dans ces immensités spectaculaires, n’ayant pas de résidence fixe. Les limites de leur territoire étaient marquées par des montagnes et des rivières et leur itinérance imprégnait tous les aspects de leur culture », lit-on sur le site « France-Tibet », succursale de « Free Tibet »... Quelle introduction poignante et pleine d'émotion,
pour ensuite affirmer depuis la pression que la Chine exerce sur eux, les nomades tibétains ont été forcés de se sédentariser. En réalité, comment s'est passée cette sédentarisation tant décriée chez nous ?

Transhumance n'est pas nomadisme
D'abord, ceux qu'on nomme des « nomades » ne sont pas vraiment des nomades, mais des « semi-nomades » ou des éleveurs pratiquant la transhumance. C'est dire qu'au moins six mois par an, ils vivent au village, dans leur ferme avec le bétail qui reste dans un enclos collé à la maison d'habitation. Il ne pourrait en être autrement : pendant les longs mois d'hiver, les températures sont intenables sur le Haut plateau, elles descendent jusque moins 40° C et les pâturages sont cachés sous une épaisse couche de neige et de glace. Les vents puissants balayent tout sur leur passage. Même les solides tentes en poils de yak ne résistent pas au vent glacial du Haut plateau.
Les éleveurs sortent le bétail vers le mois d'avril ou de mai pour les conduire aux pâturages d'été à des altitudes plus élevées, là où l'herbe est plus abondante. La période de transhumance consiste en des déplacements saisonniers : entre les mois d'avril et de mai pour l'estivage, et entre les mois d'octobre et de novembre pour l'hivernage. Elle peut durer de quelques jours à plusieurs semaines et peut couvrir des distances allant jusqu'à 300 km. Actuellement, les moyens de locomotion sont motorisés : camions, motos, 4x4 pour déplacer le cheptel. La durée de ces trajets dépend de divers facteurs, principalement des conditions climatiques et de la taille des troupeaux.
Mais finalement qu'est devenue cette tradition de transhumance du Xizang-Tibet ? Que sont devenus les semi-nomades ? Le gouvernement chinois les a-t-il réellement obligés à se sédentariser ?

Une sédentarisation forcée?
En septembre 2019, lorsque j'ai traversé leur espace privilégié d'itinérance, le plateau de Changtang, j'ai vu quelques rassemblements de tentes noires, mais fort peu comparé aux années précédentes. Par contre, je suis passée par plusieurs petites villes où j'ai vu se balader les Changpas (éleveurs du Changtang), des villes laides et froides, toutes construites de béton, distribuées sur le trajet de la grand-route qui traverse la réserve de Changtang d'est en ouest. Le guide tibétain m'a confirmé que beaucoup de familles de Changpas sont venues y vivre depuis plusieurs années. D'autres n'ont pas voulu se sédentariser et sont restés sur le Haut plateau. Ils ont continué leur mode vie traditionnel, comme auparavant.
Pourquoi cet effort de sédentarisation de la part du gouvernement ?
Cela peut se résumer en quelques mots : « plus de monde, plus de bétail ». En raison d'une croissance démographique très rapide depuis les années 1960, les troupeaux sont devenus énormes (proportionnellement à la croissance démographique). La taille des troupeaux est un facteur qui accélère la désertification du Changtang, or le Haut plateau est de plus en plus menacé par le réchauffement climatique. C'est pourquoi le gouvernement chinois, en accord avec celui de Régions autonomes concernées (Qinghai et Xizang-Tibet, principalement), a incité les éleveurs à se sédentariser, moyennant un logement gratuit et un revenu minimal assuré.
Beaucoup de familles d'éleveurs ont été attirées par les avantages que représente ce mode de vie plus confortable, moins exigeant, et se sont installées dans les nouveaux villages et les petites villes construits à la va-vite. Le problème qui s'est posé alors a été le manque d'emploi. Les nouveaux arrivants n'avaient rien à faire dans leurs nouveaux habitats. Le gouvernement régional a dû réagir rapidement.


Des nouvelles PME sauvegardent la culture et donnent de l'emploi
En 2018, des subsides importants venant principalement des provinces plus riches de l'Est de la Chine ont été distribués aux Tibétains qui voulaient ouvrir une entreprise. Lors de mon voyage en septembre 2019, j'ai eu l'occasion de visiter une entreprise de fabrication traditionnelle de chang, la bière artisanale à base d'orge. L'entreprise avait été ouverte un an auparavant par une amie de notre guide. Elle avait hérité d'une recette secrète de sa mère qui elle-même la détenait de sa mère. C'était un savoir ancestral qu'elle disait vouloir sauvegarder, aussi a-t-elle profité des subsides distribués par le gouvernement et de la réductions des taxes pour les nouvelles entreprises pour démarrer la sienne. En un an, elle a embauché une dizaine d'employés.
Au cours de ce voyage, nous sommes passés devant plusieurs autres petites ou moyennes entreprises qui avaient suivi un parcours similaire. L'une d'entre elles mettait de l'eau de source en bouteille, une autre s'occupait de la lyophilisation de la tsampa (farine d'orge, base de l'alimentation au Tibet), une autre encore était une petite biscuiterie, etc. J'ai aussi eu l'occasion de rencontrer une jeune femme qui avait ouvert un hébergement d'écotourisme et centre « wellness » non loin du lac sacré Namtso. Deux de ses oncles géraient une production de plantes médicinales cultivées en serres dans la vallée du Yarlung, près de Lhassa. Ils alimentaient le magasin de phytothérapie tibétaine ouvert par la jeune entrepreneuse.
Puis en juin 2025, lors de mon dernier voyage au Tibet, j'ai eu l’occasion de visiter plusieurs entreprises d'artisanats traditionnels regroupées sur un même site.
L'une d'entre elles fabriquait des céramiques et des poteries à base de broyats d'os de yacks, une technique traditionnelle à laquelle s’initiaient une trentaine de jeunes, ils étaient penchés avec attention sur leur travail. Sur le même site, il y avait aussi un atelier de tissage de tapis et de housses de coussins, et un autre atelier de peinture traditionnelle de tangkas.
Autant de PME qui fleurissent au Xizang-Tibet et qui ont une double fonction : donner du travail aux ex-éleveurs et à la jeune génération, et préserver des savoirs ancestraux. Tant la population tibétaine que la culture tibétaine en bénéficient.

Les serricultures contribuent à améliorer la santé des Tibétains
Une autre mesure proposée par le gouvernement régional pour résorber le chômage fut d'organiser des formations pour les anciens éleveurs. Beaucoup d'entre eux se sont recyclés dans le secteur agricole. En 2019 et en 2025, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs d'entre eux qui s'étaient formés aux techniques agricoles et étaient employés dans les serres ou des gérants de serricultures.
La vallée du Yarlung est considérée comme la région la plus fertile du Tibet, elle est relativement riche en production agricole : orge, blé d'hiver et sarrasin, pommes de terre, radis et choux, et quelques arbres fruitiers comme les pommiers et les abricotiers. Mais un des problèmes majeurs de l'alimentation traditionnelle du Tibet était le manque de vitamines, d'où l'idée de cultiver des fruits et des légumes en serres qui profitent d'un ensoleillement important, même en hiver, et contournent les problèmes liés à l'altitude. La serriculture que j'ai visitée en juin 2025 était partiellement consacrée à la culture de fraises ; les pollinisateurs étaient des abeilles qui venaient tout droit de la Belgique !
Actuellement, quand on se promène au Xizang-Tibet, on est frappé par la quantité de serres. Elles s'étalent sur des milliers de km², surtout autour des villes, ce qui diminue les intermédiaires et évite la construction d'infrastructures supplémentaires, coûteuses et polluantes (routes, principalement). Plusieurs serricultures que j'ai visitées étaient liées à des fermes solaires installées à proximité immédiate. Elles fournissent l'électricité nécessaire à la maintenance de la serre : arrosage au goutte-à-goutte avec nutriments et répulsifs bio pour les nocifs, gestion du taux d'humidité, gestion de la lumière et de la température, etc., ce sont des facteurs essentiels pour les cultures en serre.
Certaines de ces nouvelles installations, serres couplées aux panneaux solaires, pouvaient être gérées à distance par l'IA. Cela nécessite des connaissances en informatique, d'où des formations en informatique qui se sont ouvertes à Lhassa destinées aux jeunes générations issues des ex-éleveurs tibétains.

Les gardiens des réserves naturelles
Beaucoup d'anciens semi-nomades se sont investis dans la protection de l'environnement. Le Xizang-Tibet est la province-phare de la Chine en ce qui concerne l'écologie, or la préservation du vivant va dans le sens des convictions bouddhistes des Tibétains. Moyennant une rétribution qui arrondit leurs fins de mois, nombre de villageois s'impliquent dans le nettoyage des axes routiers et des pâturages, des bords de rivières et zones humides ; d'autres choisissent la plantation d'arbres pour reverdir les vallées et abords des villes.
Certains d'entre eux se sont tournés vers le métier de gardiens des immenses réserves naturelles. Actuellement, celles-ci couvrent 40% de la superficie de la région autonome du Xizang-Tibet avec, entre autres, la réserve de Changtang qui est l'une des plus grande au monde avec ses 298.000 km². Ces réserves abritent des écosystèmes uniques et des espèces menacées : antilopes, drongs (yaks sauvages), léopards des neiges, loups et renards du Tibet, pandas roux, grues à cou noir, oies à tête barrée, etc. Les gardiens des réserves contrôlent la chasse et le braconnage, et ils jouent un rôle essentiel dans la protection des espèces menacées. Par exemple, quand les antilopes migrent vers le lac Qinghai pour mettre bas, les gardiens font office d'agents de circulation, arrêtant les véhicules sur les grand-routes pour laisser passer les troupeaux d'antilopes.

Ils doivent également faire respecter les lois concernant la protection des zones préservées, par exemple, le cheptel des éleveurs est limité à un certain nombre de têtes par troupeau sans quoi il y a conflit avec la faune sauvage, le nombre de touristes est limité et doivent être en possession d'un permis spécial pour traverser les réserves naturelles. Ce sont également les gardiens des réserves qui avertissent les autorités compétentes lorsqu'ils constatent l'exploitation illégale d'une mine : charbon, cuivre, or, lithium ou autres minerais existent en quantité dans le sous-sol tibétain mais ne sont officiellement pas exploités.
Ainsi les ex-éleveurs qui ont quitté leur mode de vie traditionnel, pastoral et semi-nomade, pour se sédentariser, s'acheminent petit à petit vers des métiers d'avenir et y conduisent les générations futures.