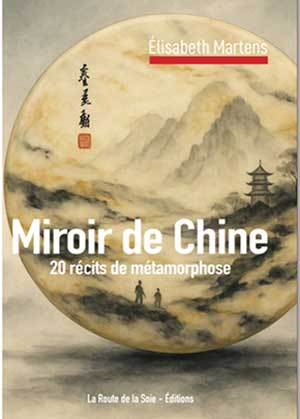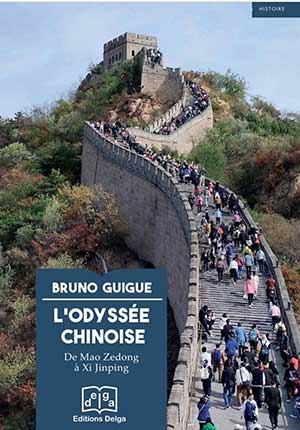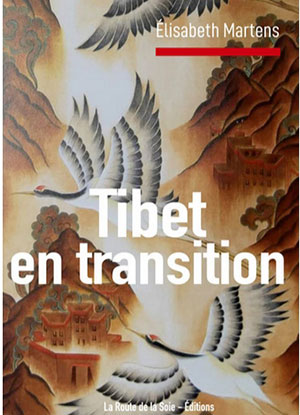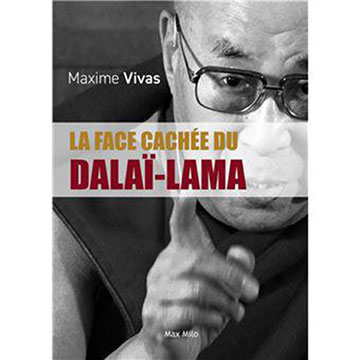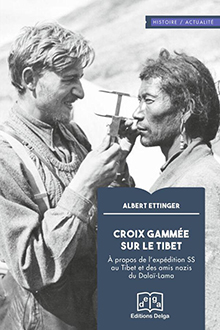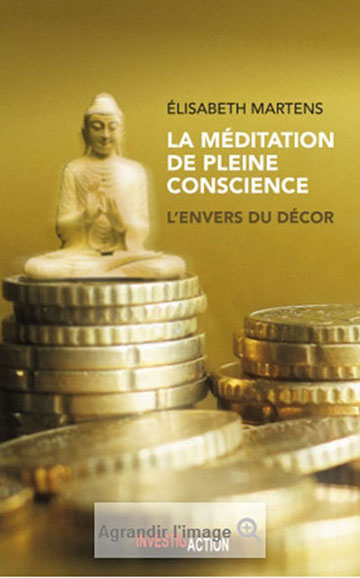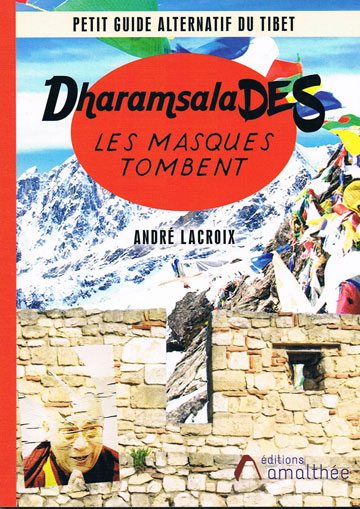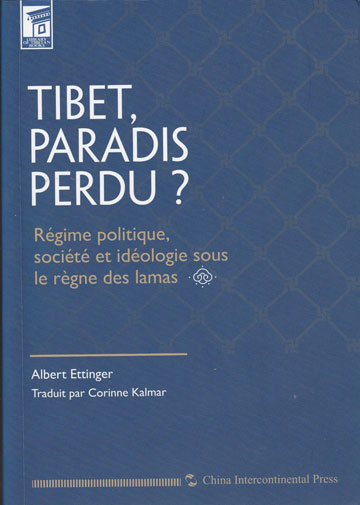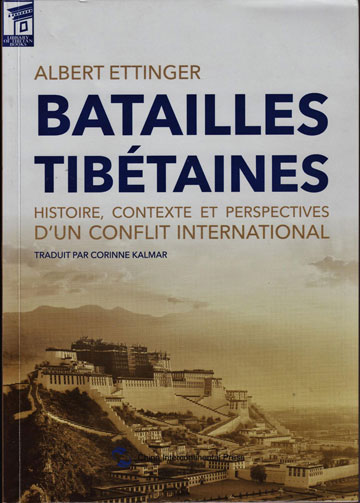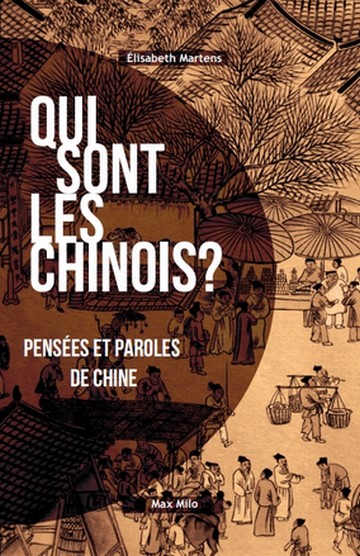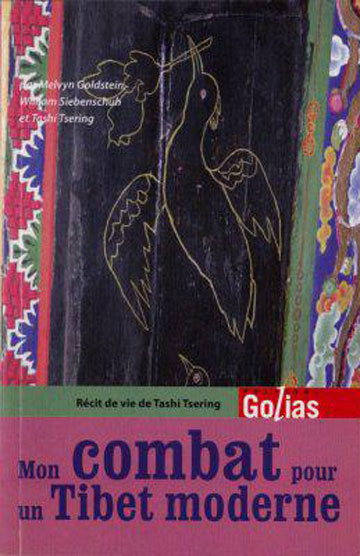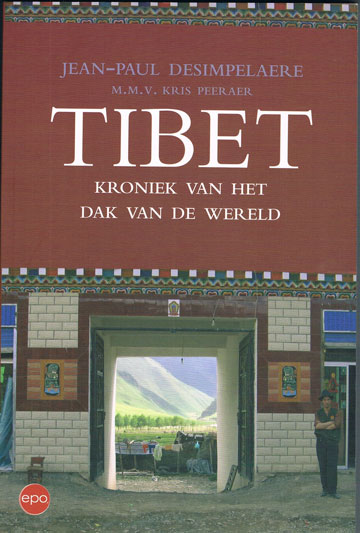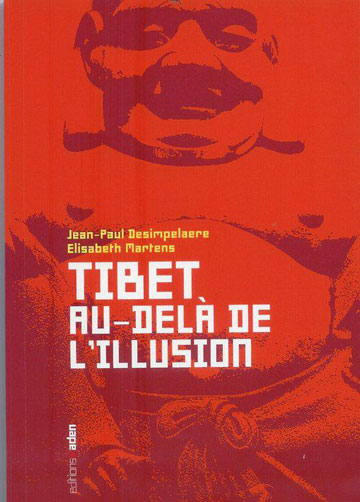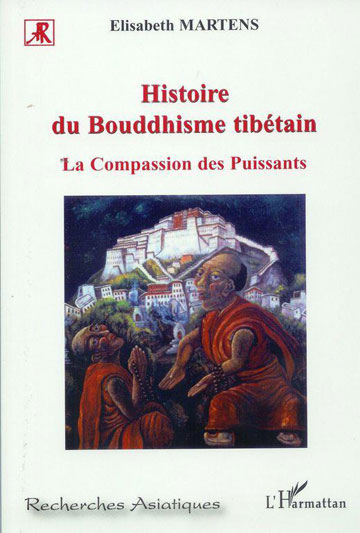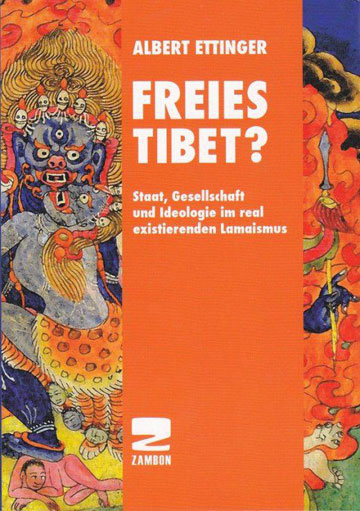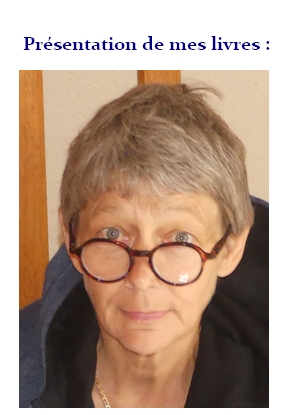« Quand le Tibet s’éveillera » passé au crible. Alexandre Adler : un curieux expert
par André Lacroix, le 17 mars 2020
Le célèbre historien et journaliste, Alexandre Adler, spécialiste des relations internationales, a publié début 2020 aux éditions du Cerf son 28e livre, dont le titre rappelle évidemment Quand la Chine s’éveillera, l’essai fameux d’Alain Peyrefitte paru il y a presque un demi-siècle. Le livre d’Adler fera-t-il date comme celui de Peyrefitte ? C’est peu probable, car, même s’il nous donne sur la question tibétaine un éclairage pour le moins original, il pèche par de nombreux défauts de forme et de fond.
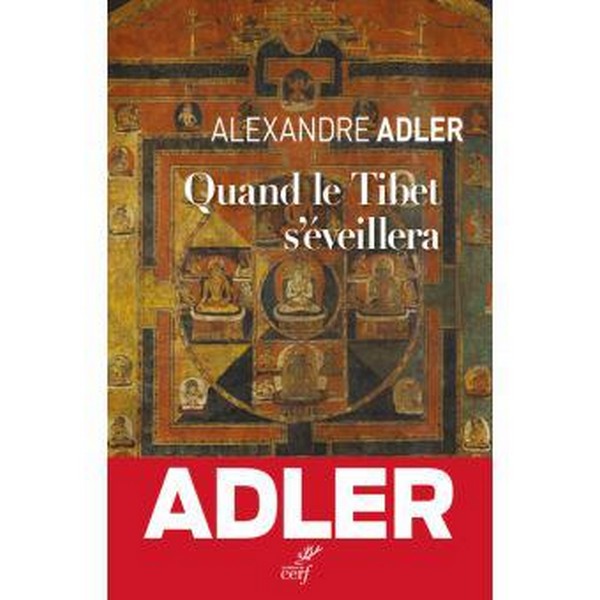
Un livre indigeste et bâclé
(Le lecteur pressé peut passer ces deux premiers chapitres portant sur des remarques formelles)
Même s’il ne fait pas 200 pages, cet ouvrage est beaucoup plus indigeste qu’un gros volume rédigé avec soin. Il est mal écrit. On y trouve des phrases kilométriques, allant de 15 lignes (p. 9 et pp. 71-72) à 17 lignes (p. 176), 19 lignes (pp. 31-32), 22 lignes (pp. 36-37) jusqu’à 27 lignes (pp. 13-14). Le style est souvent embrouillé et parfois incompréhensible : « Soyez obscur, on vous croira profond », telle semble la devise de l’auteur. On trouve même des fautes de construction, qu’on ne tolérerait pas dans une copie d’élève, par exemple : Tenzin Gyatso, que le pouvoir chinois, empêtré dans ses contradictions, ne parvient moins que jamais à se débarrasser de l’emprise (sic) (p. 170). Et dire qu’on trouve sous la plume d’AA (1) des invitations à la clarté comme : Pour le dire très simplement (p. 15) et Pour ne pas perdre notre lecteur (p. 62) ainsi qu’une condamnation des patafars (p. 105)… Que ne s’est-il appliqué à lui-même ces recommandations !
Que ne s’est-il appliqué aussi à plus de correction d’orthographe ou de langue ! Sous sa plume, toit devient « toît » (pp. 121, 122), le Panchen-Lama devient un martyre (p. 83) et l’Angleterre, quand à elle (p. 145)… Comment de telles coquilles ont-elles pu échapper tout à la fois à un auteur et à un éditeur ayant pignon sur rue ?
Qu’est-ce qui par ailleurs autorise AA à estropier quasi systématiquement les noms propres ? Il a la manie des coupes intempestives : Hu Yao Bang au lieu de Hu Yaobang (p. 18), Tsong Khapa au lieu de Tsongkhapa (p. 73), Chang Hsüeh Léang au lieu de Zhang Xueliang (pp. 155, 156) et même, c’est plutôt comique, Young husband au lieu de Younghusband (pp. 21, 138, 139). Autres incongruités : Tsinghai au lieu de Qinghai (p. 16), Padmashambava au lieu de Padmasambhava (p. 29), Choëgyon au lieu de Chö-yon (pp. 79, 82, 83), Georges Hatem au lieu de George Hatem (p. 97), Sydney Shapiro au lieu de Sidney Shapiro (p. 94), Changhaï au lieu de Shanghai (p. 108), les Tsings au lieu de les Qing (p. 130), les Hueis au lieu de les Hui (p. 137), Ma Pufa au lieu de Ma Bufang (p. 150), Eleonore au lieu de Eleanor (Roosevelt) (p. 188). Adler se croit aussi obligé d’ajouter des trémas un peu partout : Yüan au lieu de Yuan (pp. 60 et ss.), Delügpas au lieu de Gelugpas (p. 80), Israël Epstein au lieu d’Israel Epstein (pp. 91 et ss.), Kaïfeng au lieu de Kaifeng (pp. 95 et ss.), Shaül Eisenberg au lieu de Shaul Eisenberg (p. 95).
On devrait plutôt rire d’une telle enfilade de perles, mais on rit jaune quand, en tapant sur Google certains mots inventés par AA comme Choëgyon ou Delügpas, on tombe sur un renvoi à … Quand le Tibet s’éveillera de M. Alexandre Adler ! Ce genre de résultats fournis par l’intelligence artificielle pourrait donner des idées aux auteurs en mal de publicité : déformez des noms existants, et on parlera peut-être de votre livre…
Un manque criant de références
Pas une seule note de bas de page et pas une seule référence bibliographique ! C’est la règle pour les romans. Mais pour un essai présenté en 4e de couverture comme « rigoureux », cela laisse rêveur. Tout se passe comme si le lecteur n’avait qu’à avaler, comme à la radio ou à la télé, des anecdotes et des déclarations assenées avec brio. Mais, n’en déplaise aux consommateurs pressés, le livre permet davantage à l’esprit critique de s’exercer, de revenir sur une page déjà lue et de s’interroger sur le bien-fondé de telle ou telle affirmation.
Tout le livre d’AA repose sur sa mémoire encyclopédique et sur le souvenir, sûrement gratifiant, des contacts qu’il a pu avoir tout au long de sa carrière avec des personnalités de renommée internationale, comme, par exemple, le dalaï-lama et sa mère (p. 19) ainsi que son frère cadet (pp. 19, 109), le prince héritier du Bhoutan (p. 19), la directrice de Vogue Colombe Pringle (pp. 18-19), une certaine Hong, fille d’un dirigeant chinois (pp. 17 et ss.), le Professeur Wang Dadong, gendre d’un personnage illustre du PCC (p. 98), Andropov dont le père d’AA était un ami intime (pp. 99-100), (Markus) Mischa Wolf, ancien dirigeant de la Stasi (p. 112) ou encore un descendant direct du « Baron fou » von Ungern-Sternberg (p. 185), sans oublier la propre épouse d’AA, Blandine Kriegel-Valrimont (pp. 108, 195).
Quant aux sources écrites mentionnées par AA, on ne trouve que … Matthieu Ricard (p. 23) (2) et Gilles van Grasdorff (p. 93) (3) : c’est un peu court, jeune homme ! Avec une bibliographie aussi sommaire, n’importe quel étudiant serait recalé, même en invoquant une circonstance qu’il voudrait atténuante.
C’est que notre auteur a encore une autre source d’inspiration à faire valoir : … un rêve puissant, tel qu’Alexandra David-Néel les décrit, et qui nous donne l’illusion de les avoir réellement vécus. Dans ce rêve, le Dalaï-Lama faisait un retour, d’abord incognito puis dans la ferveur de tout un peuple, jusqu’à Lhassa où le gouvernement chinois l’avait invité à séjourner » (p. 22). Cet aveu permet de mieux comprendre la suite, tant il est vrai que, dans le rêve, la distinction s’estompe entre le vrai et le faux.
Des erreurs pures et simples
- p. 15 : le Tibet est appelé principauté (…) reconnue par les Nations unies. C’est tout simplement faux. Le Tibet n’a jamais fait l’objet d’une quelconque reconnaissance en droit international. La déclaration unilatérale d’indépendance proclamée en 1913 par le 13e dalaï-lama n’a été prise au sérieux par aucune Puissance, pas même par les États-Unis d’après 1945 alors qu’ils jouissaient d’un pouvoir inégalé et que la Chine n’était encore qu’un pays pauvre et méprisé.
- p. 40 : (…) la langue tibétaine étroitement apparentée à la langue chinoise mandarine (…). Tout simplement faux. Aucun linguiste sérieux n’accepterait ce rapprochement entre le tibétain qui appartient à la famille des langues tibéto-birmanes et qui s’écrit au moyen d’un alphasyllabaire utilisant 30 consonnes et 4 voyelles, et le chinois avec son système de signes pictographiques, riche de plusieurs milliers de caractères. Mais si, par acquit de conscience, vous tapez sur Google « langue tibétaine apparentée à la langue chinoise », vous tombez sur… Quand le Tibet s’éveillera. Au secours !
- p. 41 : De cette époque de Tsongkhapa commence la tradition d’équilibrer (…) les deux influences de Pékin et de Delhi, en faisant en sorte que le roi épouse deux conjointes placées au même plan : une princesse indienne (…) et une princesse chinoise (…) et p. 73 : la politique d’équilibre prônée dès son origine au XVe siècle par Tsongkhapa. AA ignore, semble-t-il, que cette pratique remonte à … sept siècles plus tôt quand l’empereur tibétain de la dynastie Tubo a pris pour épouses la princesse chinoise Wencheng (dynastie Tang) et la princesse népalaise (et non pas indienne !) Bhrikuti.
- p. 74 : (…) la fondation du Tibet au VIIIe siècle. L’an 622 est pourtant la date communément admise par les historiens. Mais qu’est-ce qu’un siècle pour un esprit supérieur qui a l’ambition d’embrasser l’histoire universelle ?
- p. 90 : (…) les descendants des Mongols, les princes mandchous, rétabliront le dernier Empire de Chine sur des bases beaucoup plus universalistes à la fin du XVIe siècle et p. 130 : (…) l’instauration de la dynastie mandchoue des Tsings (sic) à la fin du XVIe siècle (…) Quoi qu’en dise et redise AA, c’est en 1644, c.-à-d. au XVIIe siècle, que la dynastie mandchoue des Qing s’installe à Pékin. Même remarque qu’à l’alinéa précédent.
- p. 122 : (…) l’émergence du bouddhisme vers – 700. Même si certains historiens ont tendance à faire remonter dans le temps l’existence de Siddharta Gautama, on s’accorde plutôt à situer sa mort entre 420 et 380 av. J.-C. La date fournie par AA est tout simplement farfelue.
- p. 126 : Avec la méthode du bouddhisme du Diamant ou encore avec la Voie du Diamant, les Tibétains, toujours joueurs et adeptes du risque, comme un peuple qui a choisi délibérément cette hypothèse en conquérant les montagnes les plus inaccessibles, inventent le Vajrayana. Ce n’est pas exact. Les Tibétains n’ont pas inventé le Vajrayana : il a été introduit au Tibet, par exemple dans le Royaume de Gugé, par des maîtres tantriques comme Atiça qui fuyaient le nord de l’Inde.
- p. 130 : (…) la région au nord-ouest du Tibet, l’Amdo (…) Comme avec l’histoire, AA semble brouillé avec la géographie : l’Amdo se situe au nord-est et non au nord-ouest de la Région autonome du Tibet.
- p. 178 : (…) l’apogée des années de l’avant-guerre qui aboutissent en 1937 avec l’intronisation de Tenzin Gyatso au début de la Guerre mondiale. Nouvelle imprécision. AA confond la reconnaissance de Tenzin Gyatso, âgé de deux ans, comme la réincarnation du 13e dalaï-lama et son intronisation au Potala, à l’âge de quatre ans et demi, soit en 1940.
Des affirmations contestables
- p. 10 : La Chine doit donc, après une longue phase d’affrontements, trouver un moyen d’intégrer, sans en détruire les supériorités économiques et intellectuelles évidentes, le vieil Empire du Japon. Affirmation pour le moins étonnante quand on sait tout ce que la civilisation chinoise a apporté au Japon tout au long de son histoire. C’est seulement à la fin du 19e siècle que le Japon, à la faveur de sa modernisation, a dépassé la Chine alors en pleine décomposition. Mais la supériorité japonaise a pris fin avec la 2e Guerre mondiale et n’aura duré que trois quarts de siècle. Et quand on voit les progrès spectaculaires que la RPC a accomplis ces dernières décennies, on se dit que les soi-disant supériorités économiques et intellectuelles du vieil Empire de Japon ne sont évidentes que pour Alexandre Adler.
- p. 13 : (…) il [le dalaï-lama] a réussi la translation des organes vitaux de sa survie nationale dans la zone d’influence indienne où une sorte d’autonomie politique lui permet, malgré son infériorité numérique, de faire jeu égal avec le pouvoir central de Pékin. S’il est vrai que le dalaï-lama bénéficie d’une renommée internationale et d’un pouvoir d’influence sur bien des esprits, sans commune mesure avec la petite école bouddhiste dont il est le leader, ça n’en fait pas pour autant l’égal d’un président qui a la charge de plus d’un milliard trois cents millions d’habitants. Sans doute faut-il interpréter l’affirmation d’AA comme la suite de son rêve puissant à la David-Néel…
- p. 75 : AA présente les Ambans (les « gouverneurs » chinois du Tibet) comme de simples observateurs qui peuvent, théoriquement, faire venir des renforts militaires depuis le nord sinisé, mais qui dans les faits sont fortement en peine d’établir sérieusement leur autorité, lorsque les montagnards népalais voisins s’amusent de temps à autre à tailler des croupières aux Tibétains. AA oublie manifestement que, en tout cas lors de la « guerre sino-népalaise » (1788-1792), les Tibétains, envahis par les Gurkhas, ont été bien contents d’être secourus par les forces chinoises.
- p. 162 : Comme s’il avait été témoin de l’événement, AA raconte : C’est en effet Mao, qui détestait les Tibétains en général, qui interdira à Tenzin Gyatso, dans une séance dramatique tenue en présence d’un Deng Xiaoping rejetant déjà son sectarisme, de faire officiellement acte d’adhésion au Parti communiste de Chine (…) Cette vision romancée des choses est difficilement compatible avec ce que l’on sait avec certitude : l’accueil en grande pompe à Pékin, en 1954, du jeune dalaï-lama, ses contacts chaleureux avec Mao et son élection à la vice-présidence du Comité permanent du Congrès national du Peuple (4).
- p. 163 : (…) le tournant des Cent Fleurs passé en 1957, l’armée chinoise revient en force à ses plans d’occupation et à la neutralisation du Dalaï-Lama (…) Que fait AA de l’ « Accord en 17 points » de 1951 qui garantissait le respect par Pékin des institutions traditionnelles tibétaines contre la reconnaissance par Lhassa de l’appartenance du Tibet à la Chine − accord qui a été respecté pendant plusieurs années ? Les choses ont commencé à se gâter lorsque, en 1956, Pékin a entrepris une réforme agraire dans le Sichuan (dont une partie, le Kham abritait une forte minorité tibétaine), région non concernée par l’Accord. Beaucoup de riches propriétaires tibétains, laïcs et religieux, craignant de perdre leurs privilèges, ont alors pris les armes (avec l’appui de la CIA) et ont propagé leur mécontentement à Lhassa où ils ont attisé des sentiments antichinois auprès de la population locale − qui, en 1951, avait pourtant accueilli en libérateurs les soldats l’APL (Armée populaire de Libération). La suite, on la connaît, c’est la révolte de 1959, la fuite du dalaï-lama et la répression des émeutiers. Les événements auraient peut-être pris une tout autre tournure, si les États-Unis n’avaient pas décidé, en armant les Khampas, de créer au Tibet un abcès de fixation sur les flancs du colosse communiste dans le contexte de la Guerre froide. Parler de plan d’occupation, n’est-ce pas faire un procès d’intention à Pékin ? Et que penser d’un plan de neutralisation du dalaï-lama ? Était-il dans l’intérêt de Mao de se priver de cet interlocuteur privilégié qu’était le jeune dalaï-lama, par ailleurs tellement admiratif du « Grand Timonier » qu’il lui avait écrit un poème dithyrambique ? (5)
- p. 187 : selon AA, il y aurait eu, au début des années 1970, une opposition entre, d’une part, les États-Unis d’Henry Kissinger, sacrifiant le Tibet pour mieux se rapprocher de la RPC et, d’autre part, Nehru qui se refusa aux flatteries communistes de la Chine pour sauver le Dalaï-Lama, lui donner Dharamsala et créer à partir de ce point fixe un embryon d’armée tibétaine protégée par l’Inde indépendante. Cette thèse est assez difficile à admettre quand on sait que l’Inde a subordonné son acceptation sur son sol d’un « gouvernement tibétain en exil » à l’engagement états-unien d’initier à la technologie nucléaire 400 ingénieurs indiens, lesquels allaient mettre au point la première bombe atomique indienne, cyniquement baptisée « Smiling Buddha ». (6)
Plus encore que pour les coquilles, on est en droit de se poser des questions sur le sérieux des éditions du Cerf, qui se sont laissé abuser par la renommée d’Alexandre Adler et ont publié tel quel un brouillon sans en vérifier le contenu.
Tout n’est pourtant pas faux
Malgré toutes les réticences qu’on est en droit d’avoir à son égard, le livre d’Alexandre Adler fournit quand même des analyses historiques intéressantes, et des anecdotes qui ne manquent pas de sel, sur les interactions complexes qui ont existé entre les mondes indien, chinois, russe, mongol, britannique, allemand et états-unien à propos du Tibet, lequel représente encore aujourd’hui un enjeu géopolitique de taille. AA n’est pas avare d’observations et de réflexions qui, sans être des scoops pour un public informé, n’en tranchent pas moins sur la pensée mainstream à propos de la question tibétaine.
Ainsi, prenant le contrepied de l’histoire officielle, largement répandue, qui ressemble à un conte pour enfants, AA écrit : L’histoire des Dalaï-Lamas est une longue suite d’impostures, d’escroqueries ou de morts en bas âge (…) (p. 127). Plus haut il avait écrit : les Tibétains (…) qui ont (…) multiplié les infamies dans des périodes pas si antérieures que cela, auront besoin d’une longue phase d’expiation pour rendre compte des tueries, de toutes les horreurs que la classe aristocratique féodale a commises avec une parfaite bonne conscience (…) (p. 31).
AA ne craint pas de s’inscrire en faux contre l’image d’Épinal, popularisée par le dalaï-lama, d’un ancien Tibet qui aurait été « le pays le plus heureux qui soit ». Il salue le mérite d’Israel Epstein, le journaliste d’origine polonaise naturalisé chinois, qui publia des reportages photographiques atroces sur les châtiments corporels que faisaient encore subir à la fin des années 1950 (7), les adeptes aristocratiques du Dalaï-lama à de pauvres paysans tibétains entrés, pour quelle raison on ne sait, en opposition avec « Sa Sainteté ». On y voyait, même en faisant la part de certaines exagérations, le témoignage irréfutable de châtiments corporels qui pouvaient aller jusqu’aux mutilations des malheureux, rendus aveugles par transpercement des deux yeux (p. 92).
AA a le mérite de prendre ses distances avec la ligne, malheureusement partagée par de nombreux intellectuels surtout francophones, de dénigrement de la RPC et de sanctification du dalaï-lama et de ses adeptes. À l’heure où certain(e)s tibétologues de Paris ou Bruxelles ont tendance à occulter certains aspects peu reluisants de l’ « Océan de Sagesse » au point de friser le négationnisme (8), on saura gré à AA de ne pas cacher sous un voile pudique les rapports honteux que le dalaï-lama a entretenus jusqu’au bout avec son précepteur nazi Heinrich Harrer (9). C’est l’occasion pour AA d’épingler la naïveté renversante de Jean-Jacques Annaud (p. 110) qui s’est permis de porter à l’écran le livre de Harrer dont AA dit qu’il figurait parmi le tas d’ordures dont il a été bombardé, dans les années 1960, parmi d’autres publications d’une littérature produite par les syndicats libres américains pour l’édification de leurs « camarades » français de FO (p. 110). Détail amusant : tout le monde sait que le récit des aventures de Harrer a pour titre « Sept ans au Tibet » ; or AA l’intitule « Mon pays et mon peuple », ce qui est le titre des mémoires du … dalaï-lama. La confusion entre ces deux best-sellers apparaît bien comme un lapsus révélateur de l’indéfectible complicité entre les deux personnages, dont témoignent de nombreuses photos disponibles sur internet.
AA n’a pas apprécié d’avoir été quelque peu snobé par le dalaï-lama dont il se souvient qu’au cours d’une entrevue il était beaucoup plus intéressé par Vogue et par Colombe [Pringle] que par [sa] modeste personne (p. 19). AA n’avait trouvé le grand dignitaire religieux que modérément sympathique au contraire de son frère cadet, inspirant une amitié presque spontanée (p. 109). Mais, bien plus fondamentalement que cette petite piqûre d’amour propre mondain, ce que reproche AA au dalaï-lama, c’est sa relation amicale avec Harrer − et consorts, ajouterai-je (10) −, et surtout l’alignement du Tibet sur l’Axe Berlin-Tokyo dès avant la 2e Guerre mondiale : C’est alors que le crime le plus irréparable a eu lieu avec l’enthousiasme communicatif qui étreint les Tibétains au spectacle de la montée du pouvoir d’Adolf Hitler en 1933 (p. 140). AA note aussi que les flirts poussés [du dalaï-lama] avec l’Allemagne nazie (…) deviendront par la suite ses connivences avec la CIA, qui, ici comme dans bien d’autres endroits, a récupéré par le général Gehlen tout l’héritage du Troisième Reich (…) (p. 150).
Avec un tel constat, on se demande comment AA en arrive quand même à voir dans le bouddhisme tibétain un système philosophico-politique qui pourrait servir de modèle à l’humanité entière, comme dans la relation chö-yon par laquelle le pouvoir politique chinois n’aurait de légitimité qu’en acceptant l’onction du pouvoir religieux inspiré par le Kalachakra, sutra central du bouddhisme tibétain.
Lamaïsme et judaïsme
Pour comprendre la genèse de cette thèse qualifiée à juste titre, dans la 4e de couverture d’« étonnante » et de « détonante », il faut comprendre qu’Alexandre Adler fournit ici – et c’est son droit − une lecture résolument judaïsante du lamaïsme. Il intitule d’ailleurs son 1er chapitre : Padmasambhava (11) et Tsongkhapa : le Moïse et le Roi David du Tibet.
Pour comprendre ce raccourci audacieux, il faut se référer aux données historiques et même préhistoriques collectées par AA. Aux pages 115 et suivantes, il décrit la genèse du Tibet depuis le 10e millénaire glaciaire jusqu’à une époque plus tempérée qui voit se risquer vers – 2000 des peuples qui vont rencontrer les autochtones chamanistes ; parmi ces nouveaux arrivés, on trouve les « Aryens » chers aux mystagogues nazis, suite à l’arrivée des invasions indo-européennes qui submergent l’Iran (p. 120).
AA mentionne aussi la présence dans le Gandhara (dans le Pakistan actuel) des restes nullement mythiques des dix tribus perdues d’Israël qui ont choisi de s’implanter en Asie centrale plutôt que de tenter avec leurs petites élites la réinstallation que leur permet l’empereur Cyrus en Israël (p. 123). Et c’est précisément dans ce contexte tourmenté du Gandhara de l’Antiquité tardive et des débuts du Moyen Âge que fait irruption le célèbre Padmasambhava (p. 123), lequel évangélise les Tibétains dans une version déjà très avancée du bouddhisme (p. 124) (12).
Il faut savoir, en effet, que le premier bouddhisme, dit du « Petit Véhicule » (Hinayana) a été rapidement dépassé, sauf dans les périphéries du monde indien (Sri Lanka, Birmanie et Indonésie) (13) par une nouvelle version. Laquelle apparaît non seulement comme beaucoup plus inclusive, mais crée aussi un renversement métaphysique de l’enseignement du Bouddha. Dès lors il n’est plus question d’un ascétisme individuel, mais de l’instauration d’une « Voie moyenne » proche de la sagesse grecque avec laquelle elle va se conjoindre en Afghanistan, sur le plan esthétique et surtout proposer à la majorité des adeptes une organisation de la vie résolument optimiste désormais, avec le « Grand Véhicule » (Mahayana) (p. 124). Or précisément, cette révolution que de nombreux érudits indiens s’acharnent depuis le début du siècle à considérer comme « purement sémitique », est bien sûr celle que défend avec éloquence et intelligence des choses Padmasambhava (p. 125).
Étape suivante : (…) le Tibet, lorsqu’il est véritablement touché dans son cœur par le Grand Véhicule, en vient tout de suite avec son évangélisateur « adepte du Lotus » à une nouvelle formulation qui semble multiplier au cube ce que le Grand Véhicule avait déjà été au carré, par rapport au Petit Véhicule (...) Dans cette doctrine [le Vajrayana], il est question non seulement d’accéder à la réincarnation positive qui fait progresser l’humanité, mais mieux encore à instaurer un progrès exponentiel qui résulte du bouleversement permanent de la condition humaine (p. 126).
Kalachakra et Kabbale
AA est bien au courant des tares de cette Voie du Diamant, imprégnée de tantrisme, dont il ne manque pas d’adeptes qui s’effondrent dans la stupeur de l’alcoolisme ou dans la perversion de l’exercice spirituel qui débouche sur le stupre, la fornication ou l’indifférence face à autrui (p. 127). Mais, loin d’être dégoûté par ce risque du Mal, voire cette connivence avec le Mal (p. 128) qui cohabite avec la perspective salvatrice du Vajrayana, Adler, kabbaliste à ses heures, la compare gentiment avec la vision catastrophiste du talmudiste Chammaï pour qui le monde est peut-être voué à l’autodestruction, une vision qui cohabite avec celle, radieuse, de Hillel, l’autre talmudiste pour qui le monde sera sauvé par sa capacité d’amour et son indulgence (p. 173).
Le tantra principal du bouddhisme tibétain, le Kalachakra, relate, entre autres, comment un roi de Shambala apparaîtra dans le monde pour combattre les barbares et établir un âge d’or. Et cette vision millénariste doit correspondre, dixit Adler, à ce que nous qualifions dans la pensée juive comme « l’orée du messianisme » (p. 114).
Or, il n’y a pas de messie sans peuple élu. On comprend dès lors pourquoi, malgré les tares énormes qu’il a constatées et dénoncées dans le chef des Tibétains, AA les considère comme des êtres exceptionnels : il va de soi, affirme-t-il, que les Tibétains, ne l’oublions jamais, sont supérieurement intelligents dans leurs élites (…) (p. 146). Ils ont réussi à créer une élite intellectuelle tout à fait remarquable (p. 31). AA qualifie leur aristocratie de très remarquable par sa supériorité intellectuelle sur tous ses voisins (p. 75). Selon lui, les critiques ont vite été obligés de reconnaître l’extrême profondeur et l’esprit d’innovation d’un groupe humain, l’élite tibétaine des Tulkus (…) (p. 33). Dans une de ses envolées lyriques, AA déclare que le Tibet nous a surpassés dans l’ordre métaphysique, comme il a surpassé la Chine dans l’ordre politique (pp. 90-91).
Ces déclarations laissent rêveur : comment peut-on affirmer que le Tibet a surpassé la Chine quand on se souvient de la dramatique arriération du Tibet d’Ancien Régime (14) avant que les communistes chinois commencent à y construire des écoles, des routes et des hôpitaux ? Par quelle contorsion intellectuelle peut-on vanter l’esprit d’innovation d’un groupe humain qui ne connaissait même pas l’usage de la roue sinon pour les moulins à prières ? Comment peut-on admirer une élite intellectuelle qui a laissé croupir 95% de la population dans l’analphabétisme ? Réponse péremptoire du Professeur Adler : Beaucoup de Philistins sans esprit n’y comprennent rien (p. 107). Et tant pis pour ceux qui ne font pas partie du peuple élu !
Les juifs progressistes et les autres
Il y a pourtant eu, dans l’histoire, des cohortes entières de juifs remarquables qui ont dépassé cette croyance archaïque et qui se sont illustrés par leur universalisme communiste et auquel d’ailleurs AA rend hommage, comme, par ex. Annie Kappeler et son mari chinois lors de la Guerre d’Espagne (voir p. 100) ou Israel Epstein (p. 91 et passim) et Sidney Shapiro (pp. 94-95), ayant obtenu tous deux la citoyenneté de la RPC. Vers 1940, en effet, la majorité de la communauté juive américaine sympathisait, tout comme Roosevelt et son épouse Eleanor (15), avec l’idéologie communiste qu’elle cherchait à conjoindre avec un idéal américain fait de pragmatisme, de scientisme et d’antiracisme (p. 188).
Les temps ont changé, hélas ! Orphelins d’un communisme utopique, les intellectuels juifs eurent des façons très diverses de « rentrer à la maison » (p. 189). Peu à peu, à travers la notion de dialogue des civilisations, plusieurs groupes se définissent à chaud, surtout en Californie, comme des « Jubus » (16), c’est-à-dire des judéo-bouddhistes, tous de formation tibétaine et chez lesquels se produit, par une contamination qui n’a rien d’un complot, une sorte de synthèse pragmatique. Laquelle insiste, dans un premier temps, sur les aspects compatibles de la pensée juive, notamment kabbalistes, et d’un bouddhisme qui apparaît à tous les participants à ce dialogue, comme un bloc de certitude (p. 191).
Science et croyance
Et comment mieux fonder ces certitudes qu’en leur conférant une base scientifique ? D’abord en faisant abstraction du caractère éminemment religieux du bouddhisme (17), et singulièrement du bouddhisme tibétain, pour ne retenir que certains concepts qui semblent compatibles avec certains idéaux laïcisés du judaïsme libéral (p. 189). Une fois admis ce postulat, les Joubous peuvent passer à l’étape suivante : faire coïncider la dialectique bouddhiste de la « réalité ultime » et de ses « manifestations » avec les aspects ondulatoire et corpusculaire de la matière, relevés par la mécanique quantique : rien que ça ! Sans douter de rien, AA affirme : Cette doctrine est encore en mouvement, et légitime pleinement la vérité la plus profonde du Kalachakra et de ses expressions tantriques, l’affirmation totalement compatible avec la mécanique quantique moderne d’un mouvement inachevé et inassignable pour l’essentiel du destin humain (pp. 192-193).
Qu’il soit permis aux « Philistins » et autres esprits critiques de questionner la profondeur des philosophies bouddhistes et leur compatibilité avec le caractère aléatoire de la physique quantique (pp. 189-190). Cette assimilation « tantrique-quantique » ne serait-elle pas aussi discutable que le vieux concordisme judéo-chrétien assimilant les six jours de la création à autant d’âges géologiques, ou, plus près de nous, le « dessein intelligent » censé conférer au « Big Bang » un caractère déterministe préétabli ?
Pour éviter de se perdre dans les brumes de la théosophie, ne faudrait-il pas établir une frontière plus nette entre la science et la religion ? Les spéculations à prétention scientifique des Joubous, relayées par AA, ne sont pas sans rappeler l’instrumentalisation des neurosciences à des fins de prosélytisme bouddhiste (18) : sans doute Matthieu Ricard aura-t-il rencontré à Davos l’un ou l’autre judéo-bouddhiste californien…
Adler : expert ou missionnaire ?
Qu’il s’agisse ou non de régression infantile, on comprend mal que des esprits éclairés, se laissent peu à peu gagner par une foi eschatologique, quand ce n’est pas par le zèle missionnaire. Pour AA, il s’agit bien d’un défi à relever, celui, dit-il, de réconcilier la Chine que j’aime tant et le Tibet que j’ai fini par respecter bien plus que je ne l’avais imaginé (p. 26). Comme tout « bon » missionnaire, il n’est pas trop regardant sur les arguments à utiliser pour convaincre son auditoire.
En dernière analyse, et, malgré toutes ses réserves sur l’aristocratie tibétaine et sur le dalaï-lama lui-même dont la moindre n’est pas d’avoir été tenté (…) par le millénarisme d’Adolf Hitler (p. 178), AA brandit l’argument-massue qui doit emporter l’adhésion : le ralliement spectaculaire et qui n’est pas seulement tactique du quatorzième Dalaï-lama Tenzin Gyatso à la politique, mais aussi à des aspects fondamentaux de l’État d’Israël (p. 165). La messe est dite : le dalaï-lama, pour solde de tout compte, s’est rallié à Israël. Il a donc raison, et Adler aussi.
Et tant pis si, en empêchant les Anglo-Américains de survoler le Tibet pendant la 2e Guerre mondiale, les Tibétains ont fait ce qu’ils pouvaient pour aider leurs amis nazis (p. 149), responsables de la Shoah. Et tant pis si – les peuples ont de la mémoire − Netanyahu et le dalaï-lama ont partagé l’humiliation d’être refusés aux funérailles de Nelson Mandela. Et tant pis si aujourd’hui l’État d’Israël est en train de trahir des aspects fondamentaux du judaïsme. Ce n’est pas si grave après tout…
Ce qui compte pour AA, grâce au retour imprévu et de plus en plus puissant d’une judéophilie tibétaine (p. 170) et son pendant le « Dharma juif » (p. 192), c’est de mener à bien sa mission de réconcilier la Chine et le Tibet. Indépendamment de l’aspect pour le moins ambitieux de cette mission, ne voit-il pas que la réconciliation est déjà largement à l’œuvre au Tibet même, grâce au développement spectaculaire qui profite aux Tibétains du Tibet ? Ces derniers, en effet, ont compris qu’ils avaient tout à gagner à rester arrimés à la grande Chine et à travailler la main dans la main avec leurs partenaires Han pour continuer à progresser dans les domaines économiques et culturels.
Si une réconciliation doit encore avoir lieu, c’est entre Pékin et Dharamsala ; mais pour cela, il faudrait que le dalaï-lama en revienne à l’esprit concordataire du chö-yon – à laquelle il a brutalement mis fin en 1959 en dénonçant l’ « Accord en 17 points » conclu en 1951, en devenant ainsi le premier dalaï-lama de l’histoire à ne plus reconnaître la suzeraineté, sinon la souveraineté, de Pékin. Sans ce revirement fondamental du « gouvernement tibétain en exil », le rêve puissant d’Adler restera une pauvre chimère.
Post scriptum
Après la lecture de ce dernier opus d’Alexandre Adler, on ne peut que souscrire aux critiques déjà formulées par d’autres.
Dans son article Alexandre Adler, portrait d’un omniscient paru dans « Le Monde diplomatique » de juin 2005, Mathias Reymond relevait, que ce soit dans les écrits d’Adler ou ses déclarations, toute une série de fausses informations et d’amalgames, dignes des tabloïds.
Et, en 2011, c’était au tour de Pascal Boniface, de placer notre homme en tête de liste de ses Intellectuels faussaires (éd. Gawsewitch) et de le brocarder sous le titre : Alexandre Adler, les merveilleuses histoires de l’oncle Alexandre.
Adler est aussi critiqué dans le documentaire sorti en 2012 Les nouveaux chiens de garde, lui-même inspiré par l’essai éponyme de Serge Halimi, paru en 1997.
Voir aussi, sur le site « Acrimed », une série impressionnante d’articles sous le titre générique : Les Facéties d’Alexandre Adler (un médicrate tous terrains).
Les Éditions du Cerf ne sortent pas grandies d'avoir accordé leur confiance à un auteur si sujet à caution. Elles ne se sont même pas demandé si le titre n’avait pas été utilisé auparavant – ce qui est pourtant le cas : en 2007 le romancier Bernard Tabary avait déjà publié Quand le Tibet s’éveillera aux Éditions du Triomphe, spécialisées dans la littérature pour la jeunesse. Dans ce cas au moins, et quelle que soit la valeur du roman, il n’y a pas eu tromperie sur la marchandise.
Notes :
(1) AA = Alexandre Adler.
(2) Voir tout le bien que j’en pense : http://tibetdoc.org/index.php/religion/bouddhisme-tibetain-dans-le-monde/507-de-l-emerveillement-a-la-stupefaction-matthieu-ricard-peut-tout-se-permettre.
(3) Voir tout le bien qu’en pense Albert Ettinger : http://tibetdoc.org/index.php/histoire/periode-bouddhiste/187-l-histoire-secrete-des-dalai-lamas-flammarion-2009-de-gilles-van-grasdorff-un-livre-qui-souffle-le-chaud-et-le-froid.
(4) Voir Melvyn C. Goldstein, A History of Modern Tibet: The Calm before the Storm: 1951-1955, University of California Press, p. 493 et 496. « The following week, on 27 September, as the National People's Congress was winding down, the Dalai Lama was singled out for special honor; he was selected as a deputy chairman of the Standing Committee of the National. »
(5) Voir Tom A. Grunfeld, The Making of Modern Tibet, p. 116-117.
(6) D’après William Corson, major américain, responsable des négociations de l’époque, Press Trust of India, 10/08/1999. Voir aussi Raj Ramanna, ancien directeur du programme nucléaire de l’Inde, 10/10/1997, Press Trust of India.
(7) Encore une coquille ; il faut comprendre 1940.
(8) Voir http://tibetdoc.org/index.php/histoire/20eme-siecle/457-retour-sur-la-question-des-relations-tibet-allemagne-nazie-1ere-partie-des-tibetologues-negationnistes ainsi que bien d’autres publications d’Albert Ettinger, comme les cent dernières pages de son ouvrage magistral : Batailles tibétaines, Édition française China Intercontinental Press, 2018.
(9) AA parle aussi pp. 145 et ss., p. 180 – sans savoir s’il y croit − de l’apparition mystérieuse, dans l’oracle Nechung qui préside aux réincarnations des dalaï-lamas, des caractères initiatiques « A H », interprétés comme une allusion à Adolf Hitler… (?)
(10) Harrer ne fut pas le seul des dignitaires nazis avec lesquels le dalaï-lama a entretenu des relations amicales jusqu’à leur mort, sans jamais manifester la moindre contrition. Voir notamment http://tibetdoc.org/index.php/politique/exil-et-dalai-lama/240-dalai-lama-mauvaises-frequentations.
(11) Orthographe rectifiée.
(12) Sur cette intéressante question des rapports entre le judaïsme et le bouddhisme, lire les travaux de Lionel Obadia, comme https://doi.org/10.4000/socio-anthropologie.151.
(13) Sans oublier le Cambodge, la Thaïlande et le Laos.
(14) Cette arriération est bien décrite et abondamment illustrée dans Tibet, Paradis perdu ? d’Albert Ettinger, CIP, 2018.
(15) Orthographe rectifiée.
(16) En français, on parlera plutôt de Joubous. Ces judéo-bouddhistes de Californie – qu’on peut évaluer à un petit million – se trouvent avoir comme alliés objectifs quelque 40 millions de protestants évangéliques – électeurs de Trump − très présents dans le Midwest et le Sud (la « Bible Belt ») qui sont favorables à Israël comme lieu du retour de Jésus à la fin des temps. Pour les Joubous et les autres juifs, cette alliance doit apparaître quelque peu encombrante, parce qu’ils partagent rarement les dérives populistes de leurs « protecteurs » et que de plus ils n’ignorent pas que, dans les célébrations évangéliques, on prie pour leur conversion à Jésus-Christ.
(17) Lire, par exemple, Idées reçues sur le bouddhisme de Bernard Faure, éditions « Le Cavalier Bleu », 2016, pp. 45 est ss. Cet historien des religions réfute magistralement l’opinion selon laquelle le bouddhisme ne serait pas une religion comme les autres mais une pure philosophie.
(18) À lire et relire cet article décapant d’Élisabeth Martens: http://tibetdoc.org/index.php/religion/bouddhisme-tibetain-dans-le-monde/429-la-pleine-conscience-une-vitrine-du-bouddhisme-une-percee-du-bouddhisme-tibetain